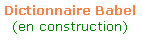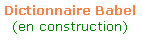| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Enki
Inscrit le: 21 May 2009
Messages: 24
Lieu: Aguascalientes
|
 écrit le Thursday 21 May 09, 7:36 écrit le Thursday 21 May 09, 7:36 |
 |
|
J'ai lu dans un bouquin d'Henriette Walter (L'Aventure des langues en Occident) que la jota espagnole apparut au XVIIème siècle, soit bien après le départ des Arabes d'Espagne. Un commentaire curieux a attiré mon attention: la linguiste parle de l'apparition de nouvelles couches de la population qui aurait généralisé ce son. Malheureusement, elle n'en dit pas plus, ce qui me laisse sur ma faim...
Quelqu'un en saurait-il plus? |
|
|
|
 |
Luc de Provence
Inscrit le: 11 Jul 2007
Messages: 682
Lieu: Marseille
|
 écrit le Thursday 21 May 09, 9:23 écrit le Thursday 21 May 09, 9:23 |
 |
|
Comme beaucoup de personnes je croyais que la jota était le produit de l'influence arabe en Espagne. Or, j'ai appris il y a peu qu'elle était apparue au XVIIème siècle.
Je pense que l'on devait prononcer le son ch comme aujourd'hui encore dans certains dialectes de la famille du Castillan comme l'Aragonais et on le transcrivait par x.
D'ailleurs dans le ladino ( ou judéo-espagnol ) des exilés du XVème siècle on prononçait sh et non la jota. |
|
|
|
 |
Enki
Inscrit le: 21 May 2009
Messages: 24
Lieu: Aguascalientes
|
 écrit le Thursday 21 May 09, 22:48 écrit le Thursday 21 May 09, 22:48 |
 |
|
| J'étais comme vous, la relation avec l'arabe me paraissait tomber sous le sens. Cela a été une surprise de découvrir que non. |
|
|
|
 |
Cuauhtémoc
Inscrit le: 22 Feb 2007
Messages: 102
Lieu: Metz (Divodorum)
|
 écrit le Friday 29 May 09, 15:36 écrit le Friday 29 May 09, 15:36 |
 |
|
| J'avais pensé que ce son était dû au fait de l'influence des langues celtiques parlées en Espagne auparavant mais également sous l'influence de l'arrivée de groupes d'Irlandais dans la péninsule ibérique dans la période médiévale (le même son se trouve en gaélique) et bien sûr la présence arabe... |
|
|
|
 |
Enki
Inscrit le: 21 May 2009
Messages: 24
Lieu: Aguascalientes
|
 écrit le Sunday 31 May 09, 10:15 écrit le Sunday 31 May 09, 10:15 |
 |
|
| Non, Cuauhtémoc, la présence arabe ne semble avoir aucune influence là-dessus car le son de la jota est apparu au XVIIème siècle en Espagne, plusieurs siècles après le retrait arabe. |
|
|
|
 |
Feintisti
Inscrit le: 09 Oct 2005
Messages: 1591
Lieu: Liège, Belgique
|
 écrit le Sunday 31 May 09, 11:33 écrit le Sunday 31 May 09, 11:33 |
 |
|
J'imagine que l'espagnol a dû subir une évolution similaire:
- au wallon liégeois: (poisson) pess(i)on > pechon > pehon; (aise) as(i)e > aje > åhe (le H est souvent rendu /x/ mais aussi /h/); à ce que j'ai cru comprendre, ce phénomène se produit également en lorrain
- à un dialecte français du Québec (Saguenay-Lac-St-Jean), où les J sont rendus /x/
Le son /S/ est une post-alvéolaire fricative sourde et le son /x/ est une vélaire fricative sourde. J'imagine que la manière de mettre la langue sur le palet en émettant ce son a changé progressivement. Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le /Z/, vélaire fricative sonore, a subi le même changement. |
|
|
|
 |
Chusé Antón
Inscrit le: 25 Feb 2005
Messages: 740
|
 écrit le Thursday 11 Jun 09, 15:33 écrit le Thursday 11 Jun 09, 15:33 |
 |
|
La lettre jota :
- le nom de cette lettre vient du lat. iōta, et celui-ci du gr. ἰῶτα
Lire le Fil La Jota aragonaise. |
|
|
|
 |
Feintisti
Inscrit le: 09 Oct 2005
Messages: 1591
Lieu: Liège, Belgique
|
 écrit le Thursday 11 Jun 09, 18:43 écrit le Thursday 11 Jun 09, 18:43 |
 |
|
| La question précise (et il suffit de lire tous les messages pour le comprendre) que pose ce sujet, c'est d'où vient le son /x/ auquel correspond la consonne J(ota), puisque dans les autres dialectes, c'est rendu comme un "dj" ? |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11180
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Friday 09 Apr 10, 22:55 écrit le Friday 09 Apr 10, 22:55 |
 |
|
[ Début d'un 2ème Fil traitant de la jota, fusionné avec un autre, plus ancien. Il se peut que certaines remarques soient redondantes avec d'autres émises dans le 1er Fil. - José - ]
J'ai lu quelque part, peut-être bien sur ce forum d'ailleurs, que la prononciation actuelle de la jota est relativement récente (XVII ou XVIIIe s.), ce qui m'a beaucoup surpris. Jusque là, on la prononçais comme le ch français, d'où Don Quichote.
Comme le phénomène est récent, on doit avoir - je suppose - toutes sortes de textes relatant ce phénomène et l'expliquant. Merci d'avance à quiconque me fournira des informations sur cette question. |
|
|
|
 |
gilou
Inscrit le: 02 Jan 2007
Messages: 1528
Lieu: Paris et Rambouillet
|
 écrit le Friday 09 Apr 10, 23:57 écrit le Friday 09 Apr 10, 23:57 |
 |
|
J'avais abordé ce sujet (mais centré sur la prononciation du x du mot Mexico) dans ce fil :
- Le x de Mexico
On avait au moyen age, du 12e au 15e siècle, un système de consonnes comme suit:
| | Bilabiales | Lamino-Dentales | Apico-Alvéolaires | Prépalatales | Palatales | Vélaires | Glottales | | Occlusives (et Affriquées) Sourdes | p | t, t͡s | | t͡ʃ | | k | | | Occlusives (et Affriquées) Sonores | b | d, d͡z | | | | g | | | Fricatives Sourdes | | | s | ʃ | | | h | | Fricatives Sonores | | | z | ʒ | ʝ | | | | Spirantes Sonores | β | | | | | | | | Nasales | m | | n | ɲ | | | | | Latérales | | | l | ʎ | | | | | Vibrante Roulée | | | r | | | | | | Vibrante Battue | | | ɾ | | | | |
Il y a eu une profonde réorganisation du système des fricatives et affriquées en castillan au 15e siècle:
L'affriquée /t͡ʃ/ est stable au cours du temps. Par contre, les affriquées /t͡s, d͡z/ perdent leur occlusion initiale, et on aboutit a une situation ou l'on a un système de 6 fricatives au début du 16e siècle:
| | Lamino-Dentales | Apico-Alvéolaires | Prépalatales | | Sourdes | s̪ | s | ʃ | | Sonores | z̪ | z | ʒ |
(si /ʒ/ avait dans certains contextes une réalisation affriquée d͡ʒ , celle ci a abouti à ʒ elle aussi à cette époque)
Ensuite, au 16 siècle, les sonores perdent leur sonorité, et on a un système réduit aux sourdes à la fin du 16e siècle:
| | Lamino-Dentale | Apico-Alvéolaire | Prépalatale | | Sourdes | s̪ | s | ʃ |
On suppose que ce changement est causé par l'influence des locuteurs du basque, qui ne connaissent que les fricatives sourdes, et par le fait que les sonores étaient assourdies en fin de mot.
L'évolution suivante a consisté en un écartement plus important de ces trois articulations:
| | Interdentale | Lamino-Dentale | Apico-Alvéolaire | Prépalatale | Vélaire | | 16e siècle | | s̪ | s | ʃ | | | Au partir du milieu du 17e siècle | θ | <---- | s | ----> | x |
Le /x/ vélaire passe au 18e en certains contextes a une articulation uvulaire /χ/, la jota moderne.
A date moderne, la prononciation continue à évoluer, le s madrilène ayant tendance a assimiler son point d'articulation avec la consonne qui suit (et pouvant par exemple être prononcé comme un x vélaire quand il est devant k)
Noter qu'en Andalousie, il y a eu une évolution différente: les palato-alvéolaires se sont confondues avec les lamino-dentales à la fin du 15e siècle. On se retrouve donc à la fin du 16e siècle, avec un seul son s̪, dental, et un son ʃ prépalatal. Ce son s̪ reste stable [quand on a ce s unique on parle de prononciation "seseo"](certaines variétés modernes le prononcent très avancé, avec un son proche de θ [on parle alors de prononciation "ceceo"]), tandis que l'articulation de ʃ recule, jusqu'à une articulation laryngale assez caractéristique d'un "accent andalou" et dans certains parlers, elle recule encore jusqu'à se confondre avec le h glottal.
La prononciation française de Quichotte (et italienne Chisciotto) pour l'espagnol Quixote nous montre qu'au début du 17e siècle, la prononciation de ce qui s'écrivait avec un x était encore un ʃ prépalatal pour certains locuteurs.
Dernière édition par gilou le Friday 22 Oct 10, 2:40; édité 5 fois |
|
|
|
 |
Luc de Provence
Inscrit le: 11 Jul 2007
Messages: 682
Lieu: Marseille
|
 écrit le Saturday 10 Apr 10, 7:45 écrit le Saturday 10 Apr 10, 7:45 |
 |
|
| Donc de grand personnages espagnols comme Cervantès ( 1547-1616 ) ou Philippe II ( 1527 - 1598 ) n'ont jamais connu la jota... |
|
|
|
 |
oliglesias
Inscrit le: 20 Oct 2010
Messages: 49
Lieu: Bretagne
|
 écrit le Thursday 21 Oct 10, 12:29 écrit le Thursday 21 Oct 10, 12:29 |
 |
|
| gilou a écrit: |
Ensuite, au 16 siècle, les sonores perdent leur sonorité, et on a un système réduit aux sourdes à la fin du 16e siècle:
| | Lamino-Dentale | Apico-Alvéolaire | Prépalatale | | Sourdes | s̪ | s | ʃ |
On suppose que ce changement est causé par l'influence des locuteurs du basque, qui ne connaissent que les fricatives sourdes, et par le fait que les sonores étaient assourdies en fin de mot. |
Tu m'intrigues... qui est ce "on"? J'ai lu, il y a quelques temps (du coup, je risque d'être vague moi aussi sur l'origine de mes propos... Mais promis, je chercherai!) qu'il était très peu probable que le basque ait pu influencer d'une quelconque manière le castillan à cette époque-là. L'aspiration du F- initial latin devenant H- aspirée en castillan, daterait de bien avant le XIIè siècle... et pour ce changement, on a l'habitude de parler de l'influence du basque, ce qui reste cohérent puisqu'à l'époque le castillan était cantonné au nord de l'Espagne et voisin du basque... Mais en ce qui concerne le changement dont tu parles, à l'époque où le castillan était si prestigieux, il me semble plus qu'improbable qu'une langue minoritaire dans la péninsule et loin géographiquement du pouvoir, ait pu d'une quelconque manière influencé le castillan.
| gilou a écrit: |
La prononciation française de Quichotte (et italienne Chisciotto) pour l'espagnol Quixote nous montre qu'au début du 17e siècle, la prononciation de ce qui s'écrivait avec un x était encore un ʃ prépalatal pour certains locuteurs. |
Ceci expliquerait en effet qu'on dise "Quichotte" en français... mais comment expliquer qu'en Amérique Latine la "jota" existe? Selon moi, les deux phonèmes ont dû coexister à partir du début du XVIè siècle et ce n'est qu'au cours du XVIIè siècle que /x/ a définitivement pris la place de /ʃ/.
Rafael Lapesa, dans Historia de la lengua española explique que Antonio de Nebrija -auteur de la première grammaire en castillan en 1492 et mort en 1522- "confondait" déjà le /ʃ/ et le /x/. Ceci explique qu'en Amérique ce son existe (il a pu par la suite être aspiré) et coexiste avec des "restes" de la prononciation palatale /ʃ/ au chili dans certains parlers.
Lapesa donne plusieurs exemples de textes du XVIè siècle qui présentent même une aspiration de la consonne initiale, ce qui invite à penser que le changement de palatale à vélaire s'était déjà produit.
Donc, dire que le son [x] est apparu en Espagne au XVIIè siècle est faux... ou du moins inexact et incomplet. Plusieurs sons cohabitent pendant de nombreuses décennies avant que l'un deux cède définitivement sa place à l'autre...
Autre remarque intéressante... En judéo-espagnol, on ne connait pas la jota /x/ ni d'autres phonèmes apparus plus tard en espagnol (comme l'interdentale par exemple, comme en Amérique) puisqu'ils ont été expulsés d'Espagne dès la fin du XVè siècle. |
|
|
|
 |
gilou
Inscrit le: 02 Jan 2007
Messages: 1528
Lieu: Paris et Rambouillet
|
 écrit le Thursday 21 Oct 10, 14:19 écrit le Thursday 21 Oct 10, 14:19 |
 |
|
| Citation: | | Tu m'intrigues... qui est ce "on"? |
Penny dans A history of the spanish language pp 98-103. Il cite Martinet (Économie des changements phonétiques) et Jungemann (La teoría del sustrato y los dialectos hispanoromances y gascones). Il cite aussi une source contemporaine, Fray Juan de Córdoba, qui montre que les changements ont progressé du nord vers le sud (quand la prononciation a changé à Madrid, elle ne l'avait pas encore fait à Tolède). La thèse de Penny, c'est que ce changement (assourdissement des fricatives sonores) était déjà effectif depuis longtemps dans les dialectes castillans du nord, influencés par le basque, et qu'il s'est introduit dans le castillan de Madrid au 16e siècle, sous leur influence, puis s'est propagé à partir de la. Le système castillan du 16e siècle étant identique en ce qui concerne ces fricatives à celui du basque, c'est une hypothèse fort envisageable en tout cas.
| Citation: | | Donc, dire que le son [x] est apparu en Espagne au XVIIè siècle est faux... ou du moins inexact et incomplet. Plusieurs sons cohabitent pendant de nombreuses décennies avant que l'un deux cède définitivement sa place à l'autre... |
Je ne pense pas avoir dit le contraire, simplement mon tableau fait ressortir ce qui est ressenti comme la norme de prononciation aux différentes époques. |
|
|
|
 |
oliglesias
Inscrit le: 20 Oct 2010
Messages: 49
Lieu: Bretagne
|
 écrit le Thursday 21 Oct 10, 15:37 écrit le Thursday 21 Oct 10, 15:37 |
 |
|
Oui, on est d'accord... Et sur le substrat basque, en fait, on l'est aussi, sauf que du coup, d'abord, tu avais fait un petit raccourci historique. Là, ça me convient mieux. Effectivement, les dialectes castillans du nord, eux, étaient en contact avec le basque depuis bien longtemps, et du coup, l'influence est possible.
Merci pour la précision en tout cas! |
|
|
|
 |
José
Animateur
Inscrit le: 16 Oct 2006
Messages: 10945
Lieu: Lyon
|
 écrit le Saturday 07 Dec 13, 14:22 écrit le Saturday 07 Dec 13, 14:22 |
 |
|
| Ce Fil fusionne 2 anciens sujets consacrés à la jota. |
|
|
|
 |
|