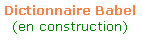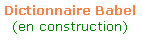| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 11:04 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 11:04 |
 |
|
D'abord un préambule : je ne connais pas l'espagnol, même si, comme tout linguiste pratiquant d'autres lengues romanes, j'en comprends plus ou moins les trois-quarts dans un texte écrit.
Je réécoutais hier quelques chansons de Barbara et le site proposait pour Les Boutons dorés une version sous-titrée en espagnol, que je ne pouvais m'empêcgher de lire. Et c'est ainsi que j'ai découverts que, si orphelin se disait « huérfano », on avait « orfanato » pour l'orphelinat, disjonction étonnante pour un mot qui est senti comme dérivé de l'autre !
Bien sûr, il y avait là pour le premier un héritage du latin orphănus, calque (sauf pour l'accentuation !) du grec ὀρφανός (cf. le mot du jour orphelin) et la diphtongaison attendue, dès la fin de l'empire romain, des e et o ouverts accentués en ie et uo (Ed. Bourciez, Éléments de linguistique romane, § 154d, p. 148), ces derniers passant ensuite à ue (ibid. § 331, p. 399), une évolution à laquelle m'avaient habitué, tous les fuego, nueve, huerta, etc. Je pouvais aussi admettre un h initial analogique de celui de huerta (?) mais d'où peut bien venir cet orfanato qui, lui, ne doit rien au latin et qui ressemble à un participe passé ? |
|
|
|
 |
embatérienne
Animateur
Inscrit le: 11 Mar 2011
Messages: 3866
Lieu: Paris
|
 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 11:29 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 11:29 |
 |
|
Je ne connais pas non plus l'espagnol, mais il semble bien que orfanato soit une formation savante sur le latin tardif orphănus 'orphelin' et le suffixe -ato, analogue à notre suffixe -at dans orphelinat.
http://dle.rae.es/?id=RB1KceI
http://dle.rae.es/?id=4GZKKGk|4GebAQt
Il y a aussi le synonyme orfanatorio, l'*orphelinatoire ! |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11180
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 12:23 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 12:23 |
 |
|
Le suffixe -ato est effectivement le suffixe nominal qui correspond au français -at. On le retrouve dans califato, par exemple.
Le suffixe du participe passé, c'est -ado.
Donc rien que de très banal dans huérfano > orfanato, au vu du déplacement de l'accent tonique. Il n'y a même pas besoin de repasser par le latin. |
|
|
|
 |
Jeannotin
Animateur
Inscrit le: 09 Mar 2014
Messages: 879
Lieu: Cléden-Poher
|
 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 14:06 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 14:06 |
 |
|
| Papou a raison, tout suffixe qui déplace l'accent tonique fait du même coup disparaître la diphtongue. Pour reprendre ton exemple avec fuego, le dérivé hogar "foyer", où l'accent est sur la dernière syllabe, n'a pas de diphtongue non plus. Les mots fierro et fuego montrent d'ailleurs que l'évolution [ɸ] > [h] devant voyelle en castillan s'est produite après la diphtongaison des ĕ et ŏ latins. Autre cas, plus d'actualité, le gentilé espagnol du Venezuela est venezolano. |
|
|
|
 |
embatérienne
Animateur
Inscrit le: 11 Mar 2011
Messages: 3866
Lieu: Paris
|
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11180
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 16:54 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 16:54 |
 |
|
Ce qu'il importe de comprendre, quelles que soient la date d'entrée en service du mot et les modalités de sa création, c'est que la langue espagnole a naturellement créé orfanato et non *huérfanato. Un tel mot est tout bonnement impensable. (En rouge la voyelle accentuée, car dans ces cas-là l'accent ne s'écrit pas.)
Cette création n'a rien à voir avec les créations savantes et tardives faites en français à partir du latin. Je répète qu'il n'y avait pas besoin de connaître le latin ou le grec pour créer orfanato, c'est une création qui allait de soi. |
|
|
|
 |
embatérienne
Animateur
Inscrit le: 11 Mar 2011
Messages: 3866
Lieu: Paris
|
 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 18:16 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 18:16 |
 |
|
| Papou JC a écrit: | | Ce qu'il importe de comprendre, quelles que soient la date d'entrée en service du mot et les modalités de sa création, c'est que la langue espagnole a naturellement créé orfanato et non *huérfanato. Un tel mot est tout bonnement impensable. |
Il a quand même pu s'écrire dans certains pays hispanophones ! |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11180
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 18:28 écrit le Tuesday 15 Aug 17, 18:28 |
 |
|
| Effectivement ! Je suis sidéré ! C'est un bon exemple de régionalisme. |
|
|
|
 |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 7:43 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 7:43 |
 |
|
| Jeannotin a écrit: | | tout suffixe qui déplace l'accent tonique fait du même coup disparaître la diphtongue |
Je trouve ce fonctionnement très intéressant et, pour moi, inattendu. Cela signifierait qu'au moins inconsciemment la diphtongaison resterait une articulation purement contextuelle, susceptible de s'effacer si le contexte prosodique change. On aboutit alors à un phénomène d'hystérésis (~ mémoire des formes) : la langue se souvient de ce qu'elle fut !
Une question me préoccupe encore : est-ce dans la compétence de chaque locuteur ? ou la connaissance de l'histoire de la langue (et, en particulier, du latin) par des érudits est-elle directrice ? |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11180
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 8:33 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 8:33 |
 |
|
Avant la pêche d'Embatérienne, j'aurais répondu - j'avais répondu - que c'était dans la compétence de chaque locuteur. Je continue à le penser. Il est significatif que huerfanato soit une particularité latino-américaine (Équateur, Argentine,...) dont il reste à trouver la cause.
Il faut savoir que dans un même temps de la conjugaison, seules les formes accentuées sur la première syllabe sont diphtonguées. C'est donc forcément dans la compétence de chaque locuteur :
puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden
ruego, ruegas, ruega, rogamos, rogáis, ruegan
C'est pas un érudit qui a inventé ça ! 
On a d'ailleurs aussi en français : je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent...
Dernière édition par Papou JC le Wednesday 16 Aug 17, 8:48; édité 1 fois |
|
|
|
 |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 8:46 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 8:46 |
 |
|
| Effectivement, l'exemple de la conjugaison apparaît décisif ! |
|
|
|
 |
embatérienne
Animateur
Inscrit le: 11 Mar 2011
Messages: 3866
Lieu: Paris
|
 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 9:08 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 9:08 |
 |
|
Je crois précisément que l'exemple des conjugaisons, parfaitement similaire au français je meurs, nous mourons, je peux, nous pouvons, je sais, nous savons, les mêmes causes ayant eu les mêmes effets dans les deux langues, montre que cela n'est pas de la compétence du locuteur moyen qui certes conjugue ainsi parce qu'il l'a appris mais est loin de comprendre le mécanisme qui régit ce qui lui apparaît (en français en tout cas) comme des irrégularités inexplicables.
Si un Français ignorant de l'histoire des mots avait à reconstruire logiquement la conjugaison de "pouvoir", il proposerait probablement "je pouve, tu pouves..." pour régulariser la chose. |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11180
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 9:17 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 9:17 |
 |
|
... ou nous peuvons, vous peuvez...
Ce que tu appelles des irrégularités (du point de vue du locuteur naïf) sont en fait des régularités (du point de vue de la langue). En fait les langues fonctionnent toutes seules, si je puis dire, sans l'intervention des érudits et en dépit des surprises des locuteurs naïfs qui finissent par se couler dans le moule d'une régularité réelle et non dans celui d'une régularité apparente.
Plus généralement, c'est un peu abusivement qu'on parle de formes irrégulières dans les langues. Elles sont irrégulières aux yeux d'un apprenant naïf qui les compare à d'autres supposées être régulières, mais elles répondent en fait à des règles phonétiques très anciennes et très résistantes. Je suppose qu'il y a aussi des petits anglophones qui inventent I breaked avant de savoir qu'il faut dire I broke.
(C'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons pour lesquelles les interventions académiques sur l'orthographe ou la féminisation posent tellement de problèmes. Les "érudits" se heurtent à des phénomènes qu'ils ne maitrisent pas, ou plus. L'orthographe française ne peut plus, au XXIe siècle, être réformée comme l'orthographe espagnole a pu l'être au Moyen Âge, avant son Siècle d'Or, et avant l'invention de l'imprimerie. Après l'invention de l'imprimerie, après la littérature du Siècle d'Or, une telle réforme aurait été impossible. C'est un peu hors sujet, mais pas complètement.) |
|
|
|
 |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 10:48 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 10:48 |
 |
|
Je trouve Papou un peu généreux avec son « très anciennes et très résistantes ». C'est oublier complètement toutes les réfections analogiques qui ont contribué à unifier et constituer les conjugaisons en français.
Dès le XVe siècle, Charles d'Orléans écrit encore ils scevent mais Villon déjà ils sçavent !
Dès qu'un verbe cesse d'être d'un usage quotidien, les fautes de grammaire simplificatrices deviennent peu à peu la norme. Et cela de façon plus ou moins anarchique. Bourciez (op. cit.) en donne de nombreux exemples §§ 291, 551b :
• le radical accentué l'emporte pour aimer, pleurer, prier, raisonner ;
• le radical atone l'emporte pour réclame, prouve, aide, mange, parle.
Parfois, la réfection a touché un verbe et non un autre de forme voisine, permettant ainsi de distinguer nier (< negare) de noyer (< necare) qui auraient été autrement confondus.
Comment Papou explique-t-il que vous dites a résisté alors que nous dimes et ils dient ont été remplacés par nous disons et ils disent sur le modèle de disant ?
Persistance de la mémoire ?  |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11180
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 11:03 écrit le Wednesday 16 Aug 17, 11:03 |
 |
|
J'avais en tête les verbes anglais dits "irréguliers".
Pour le français, il ne faut pas sous-estimer le rôle des variantes régionales qui ont pu s'imposer nationalement à la faveur des guerres et conquêtes.
Combien de réfections depuis que la France a fait son unité politique et territoriale ?
Je n'ai pas la réponse pour dites... mais là on commence à être vraiment hors sujet, non ? Sinon, il faudra le renommer et le déplacer, je ne fuis pas la discussion.
| Citation: | | Parfois, la réfection a touché un verbe et non un autre de forme voisine, permettant ainsi de distinguer nier (< negare) de noyer (< necare) qui auraient été autrement confondus. |
Qui a "décidé" cette réfection ? Des érudits ? Non, n'est-ce pas, ça s'est fait tout seul, naturellement. C'est tout ce que je voulais dire.
Pour revenir au sujet, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de comprendre et d'expliquer comment, sous quelle influence, des latino-américains ont pu créer huerfanato sans sourciller. |
|
|
|
 |
|