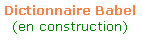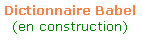| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11177
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Friday 19 Jan 18, 18:18 écrit le Friday 19 Jan 18, 18:18 |
 |
|
Serait-ce aberrant de faire l'hypothèse - faite ailleurs par moi-même - que le latin pluma pourrait être dû à un élargissement par m de pilus ?
Je pose la question car en arabe, la consonne m en position finale contribue à l'élargissement de nombreuses racines.
Je reviens au latin où je note que alma est apparenté à alo, -ere par élargissement (ou suffixation ?)
Idem pour fulmen / flavus, flumen / fluo, frumentum / fruor, ...
Il doit y en avoir d'autres, et pas seulement en latin.
Merci d'avance pour ta réponse. |
|
|
|
 |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Monday 22 Jan 18, 9:17 écrit le Monday 22 Jan 18, 9:17 |
 |
|
Il y a là beaucoup de choses qui se mélangent et qui ne sortent pas du même tonneau.
Bien sûr, frūmentum* « céréale à épi », fruor (frūctus sum) « avoir la jouissance du produit » et frūx « récolte » sont étroitement apparentés et supposent un *frūg- qui se retrouve en got. brukjan, vieil anglais brūcan « utiliser ». Et ce groupe est probablement lié à celui de fluō, flūmen, fluuius, voir pluō
Mais le m de frūmentum n'est pas un morphème isolé, il n'est que l'initiale d'un suffixe lexical issu de mēns, mentis « le principe pensant, l'intention, etc. », le même qui produisit les adverbes en -ment (it. -mente) des langues romanes. Quand au -men de flūmen, lui c'est un vrai suffixe eurindien formateur de noms d'agent (skr. brahman).
C'est lui** aussi qui forme fulmen sur fulgō « briller, embraser » issu d'un *bʰleg- bien attesté skr. bhrājate « il brille », grec φλέγω « j'enflamme » où l'on retrouve le nom d'agent au degré zéro dans φλέγμα « embrasement » < *bʰleg-mn. Mais flāuus « blond » n'a rien à voir là-dedans …
Quant, enfin, au rapprochement entre plūma et pilus, trop d'obstacles empêchent de même l'examiner. Pourquoi alors ne pas rapprocher édredon et dindon parce que le premier est garni des plumes du second ?
* pitié ! en latin u et ū sont des voyelles distinctes et on ne peut réfléchir à l'étymologie dans cette langue en les confondant systématiquement …
** lui ou *-smen ?… |
|
|
|
 |
José
Animateur
Inscrit le: 16 Oct 2006
Messages: 10945
Lieu: Lyon
|
 écrit le Monday 22 Jan 18, 10:50 écrit le Monday 22 Jan 18, 10:50 |
 |
|
| A propos de frūmentum, lire le MDJ froment. |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11177
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Monday 22 Jan 18, 11:14 écrit le Monday 22 Jan 18, 11:14 |
 |
|
| Outis a écrit: | | Quant, enfin, au rapprochement entre plūma et pilus, trop d'obstacles empêchent de même l'examiner. Pourquoi alors ne pas rapprocher édredon et dindon parce que le premier est garni des plumes du second ? |
Merci pour tout, sauf pour cette pique déplacée, et que tu regretteras peut-être un jour, mais bon...
J'avais bien noté que le i de pilus était bref, et je n'étais pas sûr que le u long de pluma soit un si gros obstacle, là où il est placé. |
|
|
|
 |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Tuesday 23 Jan 18, 11:20 écrit le Tuesday 23 Jan 18, 11:20 |
 |
|
Je piquerai toujours les rapprochements faits sur de vagues ressemblances sonores et des sémantismes trop généraux. Je comprends bien que pour un sémitiste les consonnes jouent seules le rôle central dans l'étymologie mais vouloir étendre ce principe aux langues eurindiennes n'est pas de bonne méthode. Brefs ou non, les i et u y ont un vrai statut radical et, hormis les cas d'apophonie (toujours soumis à des règles précises), ne se transforment pas au gré des envies.
Quant au sémantisme, même si poils et plumes sont reconnus aujourd'hui comme des phanères morphogénétiquement liées, nos anciens savaient bien la différence entre gibier à plume et gibier à poil, entre rôtir et braiser. Pas de poils sur un merle, pas de plumes sur la tête d'une biche …
Oui, ça m'embête déjà maintenant de te piquer, mais je ne saurais l'éviter. Moi aussi, je pense aux débutants qui, moins que toi, connaissent de phonétique historique, moins que toi connaissent les longueurs des voyelles latines … |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11177
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Tuesday 23 Jan 18, 11:58 écrit le Tuesday 23 Jan 18, 11:58 |
 |
|
Certes, mais nos ancêtres ne semblent pas avoir toujours eu la vision des choses que tu leur prêtes. Je note en effet qu'Ernout et Meillet rapprochent crīnis de crista, en dépit du fait que les i y soient de longueurs différentes et que le premier mot désigne du poil (> fr. crin) alors que le second désigne plutôt des plumes (> fr. crête) situées sur le sommet de la tête des gallinacées. Dans sa première attestation (1175), le verbe se crêter signifiait "hérisser sa crinière (lion)" (TLF).
Je me demande si ce rapprochement fait par des spécialistes valide le mien ou si ton raisonnement invalide le leur.
NB : Cette question à moi-même n'est ni ironique ni réthorique. C'est une vraie question.
Peut-être la distance phonétique de pilus à plūma est-elle plus grande que celle qui sépare crīnis de crista ? les obstacles plus nombreux ? Une forme ancienne *pilūma est-elle inimaginable ? |
|
|
|
 |
Outis
Animateur
Inscrit le: 07 Feb 2007
Messages: 3510
Lieu: Nissa
|
 écrit le Tuesday 23 Jan 18, 13:05 écrit le Tuesday 23 Jan 18, 13:05 |
 |
|
Des allongements vocaliques de produisent avant des simplifications consonantiques. On les appelle compensatoires car ils vont faire que la longueur de la syllabe ne change pas dans la simplification.
Ici crīnis repose sur un *cris-nis bien apparenté à cris-ta.
En revanche, supposer un *plusma ou un *pluxma ou n'importe quoi du même tonneau n'apporte rien de sérieux …
Nous sommes dans le domaine par excellence où comparaison n'est pas raison ! |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11177
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Tuesday 23 Jan 18, 13:11 écrit le Tuesday 23 Jan 18, 13:11 |
 |
|
Merci ! (Je n'aurais jamais proposé *plusma ou *pluxma. J'ai proposé *pilūma, mais je suppose que tu le considères "du même tonneau". Restons-en là.)
Edit (2 h plus tard) : Calvert Watkins, consulté, propose *plus-mā, sous une entrée *pleus - fournie par Pokorny - où l'on trouve également l'anglais fleece "toison". On voit que tout le monde ne rechigne pas à donner une même origine à des désignations du poil et de la plume, mais certes, fleece n'est pas pilus. Pokorny ajoute dans le panier un moyen haut allemand vlius qui est formellement bien seul, et qui signifiait "toison", lui aussi. Mais le latin pilus n'est toujours pas invité. On le trouvera chez les deux auteurs sous *pilo- en compagnie de mots où plumes et poils font là aussi bon ménage. Mais pluma n'est pas invité.
Du coup, j'ai feuilleté Watkins et trouvé une chose intéressante à l'entrée *pelə-2 "plat, étendre". Cette forme a une variante "métathèsée" *pleə- qui s'est "colorée" en *plaə-, laquelle s'est contractée en *plā-. Munie du suffixe -no-, c'est à l'ensemble *plā-no- que nous devons nos surfaces planes, nos pianos et nos esplanades. Le suffixe -mā- est aussi possible avec la même racine, ce qui a donné palme et paume, mais on n'a, sauf erreur et malheureusement pour moi, pas d'exemples de mots en plam-... C'est sans doute phonétiquement impossible. |
|
|
|
 |
Papou JC
Inscrit le: 01 Nov 2008
Messages: 11177
Lieu: Meaux (F)
|
 écrit le Friday 07 Feb 20, 15:41 écrit le Friday 07 Feb 20, 15:41 |
 |
|
| Outis a écrit: | | Brefs ou non, les i et u y ont un vrai statut radical |
Comme les deux glides du sémitique, en somme.
Ce qui m'amène à me demander pourquoi, dans la représentation des racines IE, on ne fait pas systématiquement abstraction des voyelles alternantes e et o qui, elles, brèves ou non, si j'ai bien compris, ne sont jamais radicales ?
Ainsi, par exemple, pour la racine *mer-, une graphie *mr- inattendue n'amènerait pas le béotien à se demander où est passé le e lu ailleurs. |
|
|
|
 |
|