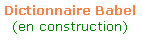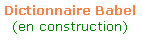| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Nikura
Inscrit le: 08 Nov 2005
Messages: 2035
Lieu: Barcino / Brigantio
|
 écrit le Saturday 04 Nov 06, 3:48 écrit le Saturday 04 Nov 06, 3:48 |
 |
|
Un sabir est une langue de relation née du besoin de communiquer entre plusieurs locuteurs de différentes origines linguistiques. Il s'agit généralement d'une forme de langage avec une syntaxe et une morphologie fort simplifiée et un lexique sommaire. Un sabir ne peut pas être une langue maternelle puisqu'il ne naît que d'un besoin de communiquer.
Le mot "sabir" est une altération du mot espagnol "saber" (savoir). Ce nom provient du parler autrefois utilisé dans les ports de la Méditerranée.
Molière y fit allusion dans le Bourgeois Gentilhomme (1670, Acte IV, scène V):
"Se ti sabir
Ti respondir
Se non sabir
Tazir, tazir."
= Si tu sais, tu réponds. Si tu ne sais pas, tais-toi tais-toi . |
|
|
|
 |
Jacques
Inscrit le: 25 Oct 2005
Messages: 6531
Lieu: Etats-Unis et France
|
|
|
|
 |
Jacques
Inscrit le: 25 Oct 2005
Messages: 6531
Lieu: Etats-Unis et France
|
 écrit le Thursday 04 Oct 12, 18:14 écrit le Thursday 04 Oct 12, 18:14 |
 |
|
| "Parler petit mauresque" a-t-il le même ton colonialiste et paternaliste que "parler petit nègre". La première expression serait-elle faite sur le modèle de l'autre? |
|
|
|
 |
embatérienne
Animateur
Inscrit le: 11 Mar 2011
Messages: 3875
Lieu: Paris
|
 écrit le Thursday 04 Oct 12, 19:06 écrit le Thursday 04 Oct 12, 19:06 |
 |
|
Merci pour le lien au dictionnaire de langue franque de 1830, témoignage important et d'ailleurs cité quatre fois dans le TLFi pour les mots barouf, maboul, moukère et turco.
L'expression "petit mauresque" a largement précédé "petit nègre" et me paraît exempte des connotations de celle-là, vu qu'elle était essentiellement la langue des échanges pas encore coloniaux dans la région. |
|
|
|
 |
rejsl
Animatrice
Inscrit le: 14 Nov 2007
Messages: 3672
Lieu: Massalia
|
 écrit le Thursday 04 Oct 12, 21:57 écrit le Thursday 04 Oct 12, 21:57 |
 |
|
Le fait que cette lingua franca ait pu être utilisée dans les relations commerciales bien avant l'époque coloniale ne garantit en rien une absence de connotation péjorative et colonialiste.
Car c'est à l'époque coloniale, aux alentours de 1830 que l'appellation petit mauresque semble usitée et ce, essentiellement par les Européens de langue française.


Ce texte, tiré d'un livre publié à la même époque ( 1830) , également à Marseille, nous donne une idée du contexte dans lequel cette expression apparaît, une idée aussi de l'état d'esprit des Européens francophones qui en usaient à cette époque. |
|
|
|
 |
embatérienne
Animateur
Inscrit le: 11 Mar 2011
Messages: 3875
Lieu: Paris
|
 écrit le Friday 05 Oct 12, 8:35 écrit le Friday 05 Oct 12, 8:35 |
 |
|
En 1830 et juste autour, les Français n'avaient encore aucune ambition coloniale en Algérie. On a certes entrepris sa conquête en 1830, coup politique destiné à occuper nos militaires en vengeant un prétendu affront, mais sa colonisation n'avait encore aucun sens, aucune réalité. C'est donc un contresens et un anachronisme que de vouloir trouver des connotations colonialistes à l'appellation "petit mauresque" (ou plus rarement "petit maure"), appellation au demeurant fort limitée dans le temps et justement disparue pendant la vraie colonisation comme la lingua franca elle-même. De plus, cette « langue » dont les spécialistes discutent encore pour savoir si c'en était vraiment une ou pas était essentiellement "la langue minimale de travail de personnages de la vie commerciale et portuaire", et n'avait pas grand chose à exprimer d'autre que des aspects très pratiques.
En revanche, que vous trouviez dans des livres de 1830, mais aussi avant comme après, des préjugés négatifs exprimés sur les Barbaresques, les Mahométans et les Maures, c'est certain et cela n'a rien à voir avec le colonialisme.
Quant à la qualification même de "petit mauresque", elle n'a rien d'injurieuse ou de condescendant ; on trouve à la même époque des livres intitulés "petit Allemand" ou "petit Français" pour « l'introduction simple et facile à l'étude de l'allemand » ou du français et l'on enseignait dans les collèges à parler en "petit latin". |
|
|
|
 |
rejsl
Animatrice
Inscrit le: 14 Nov 2007
Messages: 3672
Lieu: Massalia
|
 écrit le Friday 05 Oct 12, 9:12 écrit le Friday 05 Oct 12, 9:12 |
 |
|
On joue sur les mots, là.
La question de Jacques n'impliquait pas obligatoirement un questionnement scientifique et historique sur le colonialisme proprement dit, mais cherchait à savoir s'il y avait dans cette appellation possibilité de condescendance et connotation négative. De mon point de vue, la réponse est OUI. |
|
|
|
 |
José
Animateur
Inscrit le: 16 Oct 2006
Messages: 10945
Lieu: Lyon
|
 écrit le Friday 05 Oct 12, 9:33 écrit le Friday 05 Oct 12, 9:33 |
 |
|
Le contexte historique (et la représentation des peuples qui va avec) est une chose, le nom donné à la langue n'est pas forcément (totalement) conditionné par ce contexte.
Quand, dans le texte donné par Rejsl, on lit :
- jargon (...) qu'on appelle langue franque ou petit mauresque
"petit mauresque" ne m'apparait pas plus péjoratif que "langue franque", qui n'a rien de péjoratif |
|
|
|
 |
embatérienne
Animateur
Inscrit le: 11 Mar 2011
Messages: 3875
Lieu: Paris
|
 écrit le Friday 05 Oct 12, 13:51 écrit le Friday 05 Oct 12, 13:51 |
 |
|
| rejsl a écrit: | | La question de Jacques n'impliquait pas obligatoirement un questionnement scientifique et historique sur le colonialisme proprement dit, mais cherchait à savoir s'il y avait dans cette appellation possibilité de condescendance et connotation négative. De mon point de vue, la réponse est OUI. |
Ça n'a pas grande importance, mais la question de Jacques était précisément : "Parler petit mauresque" a-t-il le même ton colonialiste et paternaliste que "parler petit nègre". Il n'était pas question d'une connotation négative générale. |
|
|
|
 |
Glossophile
Animateur
Inscrit le: 21 May 2005
Messages: 2281
|
 écrit le Saturday 06 Oct 12, 22:32 écrit le Saturday 06 Oct 12, 22:32 |
 |
|
| Citation: | | l'on enseignait dans les collèges à parler en "petit latin". |
Le petit latin, et son parallèle, le petit grec, est une méthode d'acquisition de la langue. Elle consiste à lire un quart d'heure chaque jour, un texte simple, sans chercher à le traduire. On lit ensuite la traduction.
Un beau jour, l'apprenant s'aperçoit qu'il comprend du premier coup... |
|
|
|
 |
Azwaw
Inscrit le: 30 Aug 2010
Messages: 975
Lieu: Le Havre
|
 écrit le Tuesday 04 Aug 15, 18:42 écrit le Tuesday 04 Aug 15, 18:42 |
 |
|
Je suis tombé au cours d'une lecture sur un petit refrain chanté par les enfants d'Alger après la prise de leur ville en 1830. Le texte se compose ainsi :
El Inglès vanir, fazir boum-boum*
macache chapar Alger
El Fransès vanir, fazir Turlu-Turlututu
chapar Alger
*allusion au bombardement anglais par Lord Exmouth en 1816
C'est, je crois, assez facilement compréhensible. Le refrain raille les notables algérois et le gouvernement du Dey qui ont signé la capitulation de la ville, permettant à l'armée française d'y entrer.
Ce Turlu-Turlututu renvoie sans doute au traité de capitulation qui garantissait la protection des biens et des personnes mais qui ne fut pas respecté ; l'armée française l'ayant rédigé, de l'aveu même des autorités militaires, dans le seul but d'entrer dans la ville pour la piller. |
|
|
|
 |
Glossophile
Animateur
Inscrit le: 21 May 2005
Messages: 2281
|
 écrit le Wednesday 05 Aug 15, 0:54 écrit le Wednesday 05 Aug 15, 0:54 |
 |
|
| Citation: | | Ce Turlu-Turlututu renvoie sans doute au traité de capitulation qui garantissait la protection des biens et des personnes mais qui ne fut pas respecté ; l'armée française l'ayant rédigé, de l'aveu même des autorités militaires, dans le seul but d'entrer dans la ville pour la piller. |
Turlu-tutu est parallèle à boum-boum qui évoque une canonnade.
Les Anglais ont canonné sans prendre Alger, les Français, eux, ont fait turlu-tutu et ils ont pris la ville. Je comprends que tutlututu est une onomatopée parallèle à boum-boum évoquant une musique militaire ; les Français sont entré dans la ville sans tirer un coup de fusil, dit la chanson, stigmatisant ainsi l'attitude du dey turc qui n'a(urait) pas résisté.
On lit dans le Tlfi :
| Citation: | I. Subst. masc.
A. Fifre, pipeau, flûte, mirliton. Ce trompette qui n'avait cessé de souffler le même air dans son petit turlututu! (BALZAC, Modeste Mignon, 1844, p. 60).
P. compar. Il la mènera tranquillement jusqu'au fond de la rivière, avec ses belles phrases creuses comme un turlututu (BERNANOS, Joie, 1929, p. 620).
B. P. méton. Son aigu émis par ces instruments et, p. anal., par d'autres instruments à vent. Un bruit de trompette, un étrange turlututu d'appel se fit entendre (ZOLA, Terre, 1887, p. 124). Pourquoi, dans cette douce inspiration [la romance de Svendsen], ce petit turlututu de flûte un peu bien cocasse? (WILLY, Bains de sons, 1893, p. 213).
II. A. Onomatopée
1. [Imitant le son aigu de la flûte ou d'un instrument similaire] Faire turlututu.Chanter, jouer un air en imitant le son de la flûte. Tous les habitants du bourg auraient eu la passion de faire turlututu dans mes trompettes (SUE, Myst. Paris, t. 4, 1843, p. 343). L'oiseau pointu Qui là-haut fait turlututu (CLAUDEL, Guerre de 30 ans, 1945, p. 574) |
|
|
|
|
 |
embatérienne
Animateur
Inscrit le: 11 Mar 2011
Messages: 3875
Lieu: Paris
|
 écrit le Thursday 28 Nov 19, 19:47 écrit le Thursday 28 Nov 19, 19:47 |
 |
|
| embatérienne a écrit: | Merci pour le lien au dictionnaire de langue franque de 1830, témoignage important et d'ailleurs cité quatre fois dans le TLFi pour les mots barouf, maboul, moukère et turco.
|
Pour "maboul", voir le MDJ correspondant. |
|
|
|
 |
|