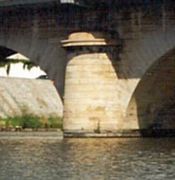Aak : bateau
de transport des petits canaux de Hollande. Il peut être gréé,
comme le tjalk dont
il est assez proche par la forme. Ce type de bateau est assez courant
en France, transformé en bateau de plaisance.
Abattre : changer de direction en allant dans le sens vers lequel le vent pousse le bateau.
About
: jointure entre deux planches du fond ou de la bordaille assemblées à
franc-bord. L'étanchéité se fait avec de l'étoupe et du goudron de
houille.
Acatus :
bateau gallo-romain des rivières du sud-ouest.
Accéléré :
sur les rivières et les canaux existaient des bateaux dits "accélérés",
c'est à dire que moyennant une taxe, ils avaient
priorité de passage aux écluses, de jour comme de
nuit. Ils étaient reconnaissables à un drapeau
rouge sur l'étrave.
Sur la Loire existait depuis
fort longtemps un service semblable, dont les bateaux se distinguaient
par leurs formes plus maritimes et une voilure plus importante,
généralement constituée de deux voiles
carrées l'une au-dessus de l'autre.
Accolin : sur la
Loire, bande de terrain entre les chemins
parallèles à la rivière, et les
grèves. C'est aussi le nom d'un affluent rive gauche de la
Loire, un peu en aval de Decize.
Accorer : synonyme
d'"équoirrer", mais moins usité
Accoster,
accostage : manoeuvre d'approche d'un bateau
vers une berge, un quai ou même un autre bateau en vue de son
immobilisation par amarrage.
Accompagnement :
technique d'exploitation de la voie d'eau qui consiste, en raison de la faiblesse
supposée ou réelle du trafic, et pour faire des économies
de personnel (Trois millions de chomeurs, ce n'est pas assez...), à
confier la manoeuvre de plusieurs écluses à un seul éclusier
qui se déplace
de l'une
à
l'autre en
précédant
le
ou les bateaux; Selon les secteurs, l'éclusier est à bicyclette,
vélomoteur,
scooter ou voiture. Ce mode de gestion, qui montre vite ses limites, s'oppose
au mode de gestion dit "en poste", où l'éclusier ne
gère qu'un seul ouvrage.
Accompagnement
dynamique : version technocratique de
la technique précédente, c'est à dire basée sur
des chiffres et uniquement sur des chiffres, sans tenir
aucun compte du facteur humain qui est le plus imprévisible par nature,
surtout concernant les touristes. Le
mode d'accompagnement dynamique utilise une belle formule mathématique
qui fleure bon la technocratie dans toute
sa splendeur, formule qui détermine, en fonction de la distance qui
les sépare, le nombre
d'écluses et celui de bateaux qu'un agent peut passer en une journée
au maximum. Bien sûr, les chiffres de base supposent que les bateaux
arrivent régulièrement
espacés, bien sagement, ce qui bien sûr n'est quasiment jamais
le cas. On peut passer 20 bateaux sur 2 écluses espacées de
2 km en une journée sans que cela
pose de problème, et le lendemain n'en passer que 10 dans un capharnaüm épouvantable.
L'accompagnement dynamique nécessite des moyens de communication performants
comme le téléphone
cellulaire entre les éclusiers souvent situés dans des zones
mal couvertes par le réseau. Il nécessite aussi des moyens
de transport pour les agents, et on finit par se demander si tout cela ne
revient pas aussi cher
qu'un éclusier sur chaque ouvrage qui occupe le temps libre entre
les bateaux
à entretenir les abords de son ouvrage, au lieu d'offrir aux navigateurs
le spectacle pitoyable d'écluses en friches, avec des maisons aux volets
clos... L'accompagnement dynamique nécessite aussi de l'éclusier
de connaitre les projets des navigateurs (en vacances, le plus souvent, rappelons-le)
pour pouvoir planifier son travail
(l'ordre de passage des bateaux). Bref, ce système représente
une source de stress pour l'agent et le navigateur. Rassurons-nous : pas
pour
le
technocrate
satisfait
de lui-même
qui voit tout cela
de loin depuis son bureau.
Acon : petit bateau
rudimentaire utilisé comme annexe
tractée par les conchyliculteurs dans la baie de l'Aiguillon
et des espaces estuariens entre Loire et Gironde (Sèvre,
Seudre, Charente). L'acon peut être
gréé. Voir "Pousse-pied".
ACP : Attestation de Capacité Professionnelle. Le permis de conduire des artisans bateliers.
Actuaire : bateau
long et facile à manoeuvrer (origine et
localisation inconnues. Il semblerait que ce bateau appartenne à l'Antiquité).
Affameur :
dans le
système de navigation dit "par éclusées",
ce mot désigne la fin du flot, qui peut laisser des bateaux ou des trains
de
bois échoués.
Affluent :
cours d'eau qui se jette dans un autre en principe plus important. Exemple
: l'Arroux est un affluent de la Loire. Dans la terminologie, on peut
préciser "un affluent rive droite" ou "un affluent rive
gauche", selon le côté où se trouve
l'affluent par rapport au cours d'eau principal : "L'Arroux est un
affluent rive droite de la Loire". La rive gauche et la rive droite
sont déterminées par rapport au sens de la
descente du cours d'eau. Cette notion d'affluent est parfois
très subjective, ou ne tenir qu'à un cheveu, comme dans le cas de l'Allier
et de la Loire. Elle peut être franchement contestable (et contestée),
comme dans celui de la Seine et de l'Yonne à Montereau, ou encore comme dans
le cas de la Guisane, de la Clarée
et de la Durance
à Briançon. En principe, au niveau du confluent,
l'affluent a un
débit
moyen
et
un bassin
versant inférieurs à ceux du cours principal. C'est le cas de la Seine à
Monterau, et même à Marcilly/Seine ! Bref, la Seine est un affluent de l'Aube
qui elle-même se jette dans l'Yonne.

Un
confluent à polémique : celui de la Seine et de l'Yonne à Montereau.
En bas, venant du sud, l'Yonne. A droite, venant de l'est, la Seine.
Et
ce qui s'en
va à l'ouest, à gauche, vers Paris, qu'est-ce donc ?
De la Seine ou de l'Yonne, lequel est l'affluent de l'autre ? Les géographes
et hydrologues sont formels : au vu des mesures des débits
et de la taille des bassins versants respectifs, c'est la Seine qui
est l'affluent de l'Yonne.
(Origine du document : Géoportail)
Afflot : sur
la Loire, crue légère suffisamment
importante pour permettre le départ de bateaux
chargés à la descente. On parle alors d'"eaux
marchandes".
Affourcher :
mouiller deux ancres de façon à ce que leurs
chaînes fassent entre elles un angle de 60 à 120
degrés, afin de diminuer le champ d'évitage sur
babord ou tribord.
Affrêtement,
affrêter : attribution d'un transport
rémunéré à un bateau. L'intermédiaire entre le commanditaire et l'artisan batelier est l'affrêteur.
Agrèner :
vider, écoper l'eau d'une chaloupe.
Agotiau :
synonyme d'écope, sur le Rhône.
Agrès : ensemble des équipements mobiles nécessaires à la bonne exploitation du bateau.
Aï : dans le
langage des bateliers : contre-courant qui se forme à l'intérieur
des virages en rivière.
Souvent traître, et parfois utile. Prononcer "ahi". Autre orthographe
possible : haïe. Rien à voir avec le sympathique petit mammifère nommé aussi "paresseux" !
Aiguille : madrier
vertical, de section carrée de 8 cm x 8, et long
de 2,50 m à 3,50 m, juxtaposé avec plusieurs
autres, et appuyé contre une volée dans
le cas d'un pertuis,
ou une structure métallique constituée de fermettes reliées par
des barres métalliques dans le cas d'un barrage mobile,
de
manière à former un rideau étanche.
C'est un système utilisé dans les pertuis depuis
très longtemps, et étendu aux barrages mobiles
par l'ingénieur Charles
Poirée dès 1834. On trouve aussi les
termes "asperges" et "pointeau".
Maquette
de pertuis à aiguilles.
Lien
: sur le site des Amis du Cher
canalisé, le principe et des photos de barrage
à aiguilles
Autre sens : ce peut être aussi, sur les bateaux de Loire,
les pièces de bois en forme de quilles (ce mot se dit aussi)
qui permettent de tendre les haubans du mât, et aussi de les
détacher très rapidement.
Aiguille de bateau de Loire.
Pour en savoir plus sur les pertuis
et portes marinières, voir l'ouvrage "Du
pertuis à l'écluse". (cliquer sur le titre)
Aiguillot :
partie mâle d'un gond, qui forme avec sa partie femelle, le fémelot,
la ferrure du gouvernail qui permet
d'articuler le safran
sur la poupe ou le tableau arrière.
Aile
: pièce de bois bloquant les planches du fond sur les deux côtés du
bateau. On appelle cela aussi semelles ou sambords pour les deux
extrémités arrondies. Les "parfaits" couvraient ausii le joint entre le
tillac et l'hélice.
Autre sens : pale d'hélice
Aiwé :
sur la Sambre, nom local pour "pertuis"
Ajas ou à-jas : ancre munie d'un jas (pièce horizontale en haut du fût)
Albrans :
sur le lac Léman, brises thermiques nocturnes qui souflent de terre entre
Evian et le Bouvret.
Alette :
terme spécifique à la batellerie occitane (sapine, coutrillon, barque
de patron...) et désignant une nervure de raidissement du
safran.

Alette d'un coutrillon
Aliénation :
décision administrative qui consiste, pour l'Etat,
à se débarrasser d'une voie d'eau qu'il a
auparavant déclassée. L'emprise de la voie est
alors vendue, par tronçons, aux collectivités
riveraines qui en font ce qu'elles veulent, le plus souvent sans aucun
égard pour l'intérêt patrimonial et
historique que présente l'ouvrage en question ainsi
condamné. Exemple : le canal
de Berry.
Allège :
dans l'ancien système de navigation sur la Loire, par trains de chalands à la
remonte, quelques bateaux vides fermaient le convoi, les "allèges. Quand un
passage délicat, du genre haut-fond, exigeait que l'on
allège d'une partie de leur cargaison les chalands, cette
cargaison était répartie dans les
allèges, puis reprenait sa place à bord des
chalands une fois l'obstacle passé.
Aller à l'étalage : se préparer à étaler, c'est à dire à freiner en laissant coulisser l'amarre sur un bollard avec quelques tours morts.
Aller à sec : échouer le bateau soit par mauvaise manoeuvre, soit volontairement.
Allonge : une courbe en
bois -dans le sens de la pièce de charpente du bateau- est
composée de deux parties pas forcément
d'égale importance : l'allonge de sole qui est horizontale
et se fixe, comme son nom l'indique, sur la face supérieure
de la sole du
bateau, et l'allonge de flanc qui est oblique ou verticale, fixée sur
la face interne du flanc du bateau.
Autre sens : sur les anciens
bateaux en bois, et notamment les péniches, pièce
de bois téléscopique qui permet d'allonger la
portée de l'amintot,
et par là de
réduire l'effort à fournir pour tourner le
gouvernail. La même chose se trouvait aussi sur les vantaux
d'écluses à balanciers,
avec la même
utilité.

Allonge
d'amintot rabattue sur celui-ci pour le passage d'une écluse
Allonger :
sur la Loire, amarrer par l'avant et l'arrière le long d'un
quai ou d'une île.
Aluette ou bigaille : jeu de cartes d'origine
espagnole, introduit sur la basse Loire par les mariniers.
Alternat : sens
unique alterné selon
des plages horaires définies par l'administration, ou
géré au coup par coup, selon le trafic, par les
employés du service. Un alternat est nécessaire
à chaque étroit dès
qu'il atteint une certaine longueur (dans un bief de partage
comprenant voûtes
et tranchées par
exemple), aux grands ponts-canaux, aux écluses
multiples... À Paris, le grand bras, entre les
îles et la rive droite, est réglementé
par un alternat signalé par des feux. Le petit bras de la
Monnaie, lui, est à sens unique montant.
Alveus :
pirogue monoxyle gauloise. Même étymologie que le français auge.
Amarre : corde
munie d'une large boucle à chaque extrémité,
utilisée pour sécuriser le bateau dans les
écluses, et l'attacher à la terre ferme lors
d'une escale. "Bout" est maritime et donc impropre.
Amarrer : solidariser
son bateau avec la terre ferme au moyen d'amarres. Contraire : démarrer,
tout simplement ! ... et non pas "désamarrer" qui est un
très laid barbarisme à proscrire.
Amintot :
long timon de la barre franche de la péniche tractionnée.
Il est téléscopique en deux parties, pour pouvoir
rabattre le gouvernail à angle droit sur
l'arrière du bateau, de façon à tenir
le moins de place possible dans les écluses. Ce terme vient
de la batellerie du Nord.

Amintot.

Amintot replié avec son allonge
Amont : par rapport à l'observateur,
partie de la rivière ou du canal comprise entre lui et la
source ou le point le plus haut du canal . Si l'on regarde une
rivière qui coule de gauche à droite, l'amont est
à gauche. Moyen mnémotechnique : amont renvoie à montagne, donc est en
haut.
Amour Baiser Caresse : petit nom gentil pour les moteurs à régime semi-lent de l'Anglo Belgian Corporation (ABC) qui équipent beaucoup de bateaux.
Amphidrome : adjectif
qui qualifie un véhicule qui n'a ni avant ni
arrière définis, et peut se mouvoir
indifféremment dans les deux sens. Certains bateaux le sont.
Ancierre :
cable de halage. Synonymes : fintrelle, verdon, maillette, grelin (dans
le Cotentin).
Ancre :
organe mobile destiné à freiner le bateau,
jusqu'à son arrêt total. L'ancre se jette par
dessus bord ou se descend au moyen d'un treuil, et elle est
reliée au bateau par une chaîne. Sa
présence est obligatoire à bord, mais son usage
n'est autorisé qu'en rivière : en canal, l'ancre
dégraderait la couche d'argile ou de béton qui
tapisse le fond de la cuvette.

ancres d'un automoteur de canal
Ancriau ou ancriot :
petite ancre à main, dont une des pointes est
remplacée par une poignée.
Anguillet : sur les bateaux en bois ou en
métal, découpe ménagée dans
les rables
et les allonges de sole des courbes pour
permettre à l'eau de s'écouler jusqu'au sentineau où elle est
recueillie et écopée ou pompée.

Anguillets dans un
bateau de Loire
Anodonte :
mollusque bivalve très courant dans les rivières et canaux, et couramment appelé
"moule d'eau douce". L'anodonte, dont la coquille peut dépasser 10 cm de long,
n'a
certainement
aucune
valeur
gastronomique
(excepté pour le ragondin et le héron cendré) car ça se saurait. Et c'est bien
dommage.

Anodonte
Apéro :
mot
qui revient très fréquemment dans le langage du plaisancier. Il
semble être à la fois un signe de reconnaissance et un sésame
qui ouvre bien des portes, ce qu'exprime l'aphorisme suivant : à bâbord, c'est la gauche, à tribord, c'est la droite, et à ras-bord, c'est l'apéro. Voir à ce sujet le site Aquanomade et
notamment le forum. Ne
pas confondre avec "apparaux" qui suit, phonétiquement proche,
mais d'un tout
autre usage.
Apparaux :
ensemble du petit matériel dont la présence est
réglementairement obligatoire à bord d'un bateau.
Cela va de l'extincteur au guide fluvial, en passant par les amarres,
l'ancre, les bouées, des avirons, des gaffes, une corne de
brume. On parle aussi de "matériel d'armement".
Apparêt
ou appareil : planchette en
bois d'environ 40 cm sur 30, munie d'un long manche, et faisant partie
du système d'obturation de certains types de pertuis,
comme sur le Loir, où les apparêts se placent
entre des aiguilles qui
comportent des feuillures ad-hoc. Un tel pertuis peut avoir ainsi plus
de cinquante apparêts. Voir site. Synonyme : bouchure.
Apparêts
de pertuis (maquette).
Pour en savoir plus sur les pertuis
et portes marinières, voir l'ouvrage "Du
pertuis à l'écluse". (cliquer sur le titre)
Appe : petit
crampon métallique qui
maintient en place la baguette de protection du calfatage des
bordés d'un bateau.
Appel : manoeuvre directionnelle couramment
employée en kayak et canoë.
Le pagayeur plante la pagaie dans
l'eau, latéralement à lui, à la
perpendiculaire de l'axe du bateau et le plus loin possible, de
façon à ce que la face active de la pale le
regarde. Puis il ramène la pagaie vers lui, ce qui a pour
effet de rapprocher le bateau de la pagaie (qui est
considérée comme un point fixe), et de le faire
pivoter
comme l'aiguille d'une boussole.
Une forme
particulière d'appel, qui permet des manoeuvres
très fines, est l'appel navette qui
utilise l'incidence de la pale selon
une technique très semblable à l'aviron en godille sur une barque.
La manoeuvre exactement inverse de l'appel est l'écart.
Animations
: l'appel
classique, l'appel
débordé, l'appel "navette"
Appui : tenue spécifique de la pagaie, en kayak et canoë,
dans un but de stabilisation. Le pagayeur prend appui sur l'eau au
moyen de la pale de
la pagaie, latéralement à lui. On distingue
principalement l'appui en pousée, dans lequel la pagaie est
tenue basse, presque parallèle à la surface de
l'eau, et
l'appui en suspension, dans lequel le pagayeur tient sa pagaie oblique,
les bras levés au-dessus de sa tête. Cette
dernière
méthode peut voir son efficacité
multipliée en
imprimant à la pagaie des mouvements d'aller-retour d'avant
en
arrière avec changement d'incidence à chaque
changement
de sens, comme dans l'appel
navette. L'appui est alors en dynamique.
Animation
: les
appuis en canoë.
Aquamoteur
: moulin-bateau d'une
type spécial affecté autrefois à
un usage bien particulier : le treuillage de bateaux à la remonte,
là où le courant trop fort nécessitait
un sérieux renfort. Il y en avait un, au XVIIIe
siècle, sous le Pont Neuf à Paris. Il est
présenté dans la grande Encyclopédie
de Diderot et D'Alembert (chapitre "l'Art de Charpenterie").
Aquavipathie
(et aquavipathe, aquaviphilie, aquaviphile) : étymologiquement,
"maladie de la voie d'eau". Affection - bénigne ou maligne,
seule la science, plus ou moins infuse, pourra le
déterminer
- qui touche des individus ordinaires, femmes et hommes, et se caractérise
par une attirance affective maladive vers la voie d'eau. L'aquavipathe
souffre mais ne le sait pas. Au contraire même, il éprouve
un certain bonheur dans son état. En revanche, c'est son entourage
qui trinque : les lieux de vacances par exemple sont choisis en fonction
de la proximité
ou non de sites fluviaux intéressants pour satisfaire sa monomanie,
les trajets eux-mêmes sont déterminés par cette même
préoccupation, pour
ne donner que quelques exemples simples. On peut distinguer l'aquavipathe
monomaniaque qui éprouve un attachement excessif pour la voie
d'eau qui passe devant chez lui, et ne connait guère les autres,
et l'aquavipathe total qui est attiré, où qu'il soit, par
tout ce qui porte bateaux en eau douce, quelle que soit la région
ou le pays. Mais la frontière entre
ces deux degrés d'affection est très floue, et il est courant
qu'un aquavipathe monomaniaque voit son état empirer et glisser
vers l'aquavipathie totale.
L'aquavipathe (et sa forme légère l'"aquaviphile") se repère
facilement
à son habitude de venir trainer aux abords des ouvrages de navigation
: écluses, ponts-canaux, réservoirs, etc., souvent équipé d'un
appareil photo, d'un calepin pour prendre des notes et même un mêtre pliant et un décamètre. Quand il est
plus sérieusement
atteint, on le trouve aussi aux archives municipales et départementales,
ou dans celles des services de la navigation (quand ceux-ci n'en ont
pas fait des feux de joie). On le trouve aussi bien sûr dans
les musées
consacrés à la voie d'eau, et assez rapidement en train
de farfouiller dans les réserves ou la documentation. On peut
le retrouver à travailler
au sein des services navigation, mais il s'expose alors
aux pires ennuis du fait de l'incompréhension dont il sera l'objet
de la part de sa hiérarchie. Sauf si bien sûr, parmi cette
même hiérarchie se
trouve un autre aquavipathe, ce qui, il faut bien le reconnaitre (et
certains diront : le déplorer), est extrêmement rare.
L'aquavipathe peut éprouver une jouissance quasi-orgasmique sur le plan
intellectuel à la découverte d'un ouvrage rare et ignoré de tous, genre paléo-écluse,
ou ancien tracé d'un canal disparu sur une carte ancienne.
Dans ce que tout un chacun ne verra qu'un vieux tas de pierres taillées,
l'aquavipathe voit un ouvrage d'un extrême intérêt qu'il faut sans délai
classer aux
Monuments Historiques.
L'aquavipathie s'accompagne généralement d'une tendance au prosélytisme.
Aussi ne sera-t-on pas étonné de voir l'aquavipathe rédiger des articles
pour des magazines, écrire des bouquins, présenter des conférences,
ou créer un site internet, consacrés au sujet. Il peut être modéliste
aussi, bien sûr. Assez souvent aussi, son rêve
sera de posséder son propre bateau, comme l'aquaviphile. On
en connait même qui ont fait le pas et se sont retrouvés
mariniers, alors que rien dans la famille ne semblait les prédisposer à cela.
Aussi méfions-nous
: l'aquavipathie n'est pas forcément héréditaire,
elle est plutôt contagieuse.
D'ailleurs les aquaviphiles les plus atteints, et bien sûr les
aquavipathes, ont tendance à se regrouper en associations un
peu comme les Alcooliques Anonymes. Mais à la différence
de ces derniers, leur but n'est absolument pas (nous dirions même
: surtout pas) la guérison, mais au contraire
l'entretien mutuel de leur pathologie, voire son développement.
L'aquavipathe verrait d'un bon oeil sa progéniture tomber dans
le même
vice que lui, mais celle-ci, rien que pour l'embêter, deviendra
ingénieur en aéronautique,
na. Ca ne fait rien, comme il y a "nautique" dedans, l'aquavipathe
est content quand même.
Est-ce grave, Docteur ? Bof...
Aqueduc :
canalet en tunnel ou à ciel
ouvert qui emmène l'eau d'un point à un autre
(parfois fort éloignés) par gravitation,
éventuellement aidé par des pompes. Un aqueduc
peut passer sur un pont, comme le pont du Gard ou l'aqueduc de
Montreuillon (Nièvre). Quand un aqueduc est
utilisé pour l'alimentation d'un canal, on emploie le terme
de "rigole".
Les péripéties et
aléas de la construction d'un aqueduc
célèbre : Maintenon. (Cliquer ici)
Aqueduc-siphon :
ouvrage d'art qui permet à un cours d'eau de faible
importance de passer sous un canal, par le principe du siphon : sous le
canal, l'eau descend d'abord puis "remonte" à la sortie de
l'ouvrage. Quand le cours d'eau est plus important, il est
préférable d'employer un pont-canal quand la configuration
des lieux l'autorise.

Aqueduc-siphon sur le canal
de Roanne à Digoin.
Araignée :
voir "croix
de Lorraine".
Arbouvier : sur
le Rhône, synonyme de "mâtereau" ou
mât de halage. On dit aussi "aubourier".
Arche marinière
ou arche batelière : dans un pont à plusieurs arches, celle prévue pour le passage
des bateaux. Elle est généralement plus large et
haute que les autres, et la profondeur du chenal y est garantie. Il
peut y en avoir plusieurs, auquel cas on s'arrange pour leur attribuer
un sens unique : une arche pour les avalants , balisée deux
carrés jaunes à l'amont, un carré
rouge barré transversalement de blanc à l'aval,
une autre pour les montants balisée de la même
façon mais dans l'autre sens, et éventuellement
une troisième à double-sens, balisée
un carré jaune de chaque côté. Dans les râcles,
elle n'est pas balisée : on est censé savoir que
le chenal se trouve le long du chemin de halage.
Archéo-écluse :
néologisme pour "bassin à
portes marinières". Mais peut-être
faut-il lui préférer celui de "paléo-écluse"... La
découverte de ce genre d'ouvrage envoie l'aquavipathe directement au nirvana.

Archéo-écluse
de La Salle, sur le Thouet
(photo J.Sigot)
Cliquer
ici pour voir l'image agrandie)
Pour en savoir plus
sur les archéo-écluses, voir l'ouvrage "Du
pertuis à l'écluse". (cliquer sur le
titre).
On peut consulter aussi le Site
de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde
des Moulins.
Ardennais : synonyme
de "mignole".
Argentat : ancien
bateau de charge de la
Dordogne à usage unique comme les sapines de
la Loire. Synonyme "courpet".
Etymologie : d'Argentat, la ville où ces bateaux
étaient construits.
Arpie : sur le Rhône, longue perche
pour propulser une barque. C'est un bâton de
marine ou une gaffe armé en son
extrémité d'un embout
métallique comprenant une pointe et un
crochet. On écrit aussi "harpie".
Arrière-bec :
forme de la face aval d'une pile de pont, de plan pointu, rond ou ogival par
nécessité hydrodynamique, et
destinée à éviter ou limiter les
contre-courants qui se forment en arrière de la pile. (Voir "avant-bec").
Arrivotes : renforts
de bois placés de part et d'autre de
l'étrave du bateau de commerce, moins importants que les "moustaches".
De nos jours, sur les bateaux métalliques, moustaches et
arrivotes se confondent. La même chose existe à
l'arrière et s'appelle "dérivotes".
Arronçoir
: sur les anciens bateaux
de la Loire (toues, chalands) et de la Seine (marnois
principalement, mais aussi parfois foncets
et besognes), planche
de bois dur,
dont le bord inférieur est taillé en forme de
crémaillère, et placée sur les
côtés du bateau à l'avant et
à l'arrière, souvent en plusieurs exemplaires en
autant de niveaux. Lorsque le marinier, placé à
l'avant du bateau, voit celui-ci se diriger vers un haut-fond ou un
rocher dangereux, il pointe son bâton de marine vers cet
obstacle, et cale l'autre extrémité, celle par
laquelle il tient le bâton, dans les dents de
l'arronçoir. Ceci a pour effet de déporter
violemment le bateau sur le côté,
évitant ainsi l'obstacle. Plus d'un marinier a
laissé un ou plusieurs doigts dans les arronçoirs
en pratiquant cette technique nommée "bournayage". On voit
parfois aussi le terme "rançoir".

Arronçoirs
sur un
bateau de Loire.
Ascenseur à bateaux :
ouvrage
permettant aux bateaux de franchir rapidement un fort
dénivelé, sur le principe de l'ascenseur. Il en
existe plusieurs exemplaires de par le monde, notamment en Allemagne,
Belgique et Canada, et de plusieurs systèmes : à
pistons, à flotteurs, funiculaire… Le dernier en
date, construit en 2000 à Falkirk en Ecosse, fonctionne
comme une roue de fête foraine. Un autre, funiculaire,
contemporain et construit en Belgique, à
Strépy-Thieu, est le plus haut du monde avec un
dénivelé de 74 mètres (et dire qu'on
parle de plat pays !). En France, celui des Fontinettes, à
Arques, est hors service depuis 1968, et celui de
Saint-Louis-Arzviller, dans les Vosges, en service depuis la
même date (mais c'est plutôt un plan
incliné, voir ce mot). Le système des
ascenseurs à bateaux remonte à la fin du XVIIIe
siècle, avec des ouvrages rudimentaires, mais
préfigurant déjà ce qui se fera par la
suite, établis dans les Monts Argentifères de
Saxe, ou sur le Dropt en
France. Un
ingénieur allemand, Eckhard Schinkel a consacré
tout un livre à ces ouvrages : "Schiffslift"
(éditions Klartext).
Ascenseur à bateaux
de Houdeng, sur le canal du Centre belge.

L'ascenseur
de Falkirk, en Ecosse, que vous
pouvez voir fonctionner en cliquant
ICI.
Asperge :
dans le jargon des barragistes, synonyme d'"aiguille".
Assemillage : sur le bateau, appareillage, équipement en organes
fixes et mobiles (treuils, bollards, chaumards...). Equivalent fluvial de l'accastillage
marin.
Associations :
avec le regain
d'intérêt manifesté par le grand public
envers la voie d'eau depuis les années 1970, sont
nées des associations de sauvegarde et de valorisation de ce
patrimoine. Certaines se fixent pour but l'étude et la
promotion des canaux de leur région, comme "Autour
du Canal de Bourgogne", le "Fluvial-Club
de Briare", les "Amis
du Canal
Latéral à la Loire", les "Amis
du Canal du Nivernais", le "Comité de
Développement
du Canal du Centre".
D'autres se sont assignée la tâche plus lourde de
parvenir à la remise en état de
navigabilité de leur voie d'eau, comme l'Association
pour la
Réouverture du Canal de Berry ou l'Association
pour la Navigation du Canal d'Orléans". Ces
associations sont des interlocuteurs et des partenaires des organismes
officiels de l'Etat comme V.N.F. ou les instances
départementales et régionales. Elles font aussi
connaître leur action à travers des manifestations
festives régulières. Ne se contentant
d'être en lien et en synergie les unes avec les autres (à travers,
notamment,
l' "Entente
des Canaux du Centre"),
certaines sont jumelées avec d'autres associations
étrangères du même genre, et organisent
des voyages d'échanges culturels. D'autres associations
étendent leur action sur l'ensemble du territoire
français, dans un but ouvertement culturel, comme l'Association
des Amis du Musée de la Batellerie de
Conflans-Sainte-Honorine, ou "Hommes
et Cours d'Eau".
D'autres enfin se consacrent à
l'intérêt pratique des plaisanciers, comme l'A.N.P.E.I., "Association
Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures".
Citons enfin Aquaforum et
Aquanomade qui
permettent un échange direct sur internet aux plaisanciers, voire entre
plaisanciers et professionnels.
Atterrissement :
dépôt d'alluvions sur un haut-fond, finissant
par émerger hors de la surface de l'eau. Nuisible
à la navigation, bien sûr.
Aubert (hausses) :
système de bouchure de barrage mobile inventé par l'ingénieur Aubert à la
fin du XIXe
siècle. C'est une amélioration et une
simplification des
systèmes Chanoine
et Pasqueau.
Les hausses Aubert sont de grands panneaux rectangulaires d'environ 3
mètres de haut sur un peu plus d'un de large, qui pivotent
sur
leur base. La hausse est maintenue dressée grâce
à
une béquille articulée sur sa face
postérieure
(aval) qui s'appuie sur un sabot à échappement,
fixé sur le radier,
comportant trois ou quatre positions, selon le degré
d'inclinaison qu'on veut donner à la hausse quand elle n'est
pas
totalement couchée pour une crue.
Nota
:
cet ingénieur Aubert ne doit pas être
confondu avec son homonyme qui a inventé la pente d'eau dans
les
années 1970. Ni avec l'ex-chanteur de Téléphone...

Hausses
Aubert du barrage de
Saint-Léger-des-Vignes
Les béquilles
sont bien visibles, et les sabots se devinent dans l'eau.
Aubourier :
synonyme de "arbouvier".
Aussière : autre nom d'une amarre. Plutôt maritime comme "bout".
Autieu ou otieu : voir "outiau"
Automoteur : bateau
de commerce
motorisé, par opposition au bateau tractionné, à la barge nue ou au convoi poussé.
On distingue
l'automoteur de canal,
généralement de gabarit Freycinet, et l'automoteur
de
rivière, plus grand et aux lignes plus élancées. Ce dernier se décline
lui-même en plusieurs types (canadien, campinois,
rhénan, danubien, chaland de Seine...).
Auvergant ou auvergond, overgand :
voir "overgand".
Auvergnate : sapine
fabriquée sur le haut Allier, comparable
à la ramberte sur la Loire.
Auverlope : voir "overlope".
Aval : par rapport à l'observateur,
partie de la rivière ou du canal comprise entre lui et
l'embouchure ou le point le plus bas du canal. Si l'on regarde une
rivière qui coule de gauche à droite, l'aval est
à droite. Moyen mnémotechnique : aval renvoie à vallée,
donc est en
bas.
Avalaison : navigation à la descente. Sur le Rhône, on parle
de "descize".
Avalant :
bateau qui descend le canal ou la rivière (il
s'éloigne de la source ou du bief de partage). À
taille égale, l'avalant est prioritaire. On dit aussi que le
bateau "baisse". On parle aussi d'"écluse avalante". Il s'agit simplement d'une
écluse ordinaire que l'on franchit dans le sens descendant.
Avances :
Acompte versé au marinier avant de quitter son port de
chargement, correspondant généralement
à 50% du
fret.Avant-bec :
forme de la face amont d'une pile de pont, de plan pointu, demi-rond ou
ogival par nécessité hydrodynamique, et
destinée à faciliter l'écoulement de
l'eau de part et d'autre de la pile. (Voir "arrière-bec").
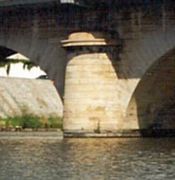
Avant-bec
d'une pile du pont de Roanne.Avarie : dommage subi par le bateau et/ou sa cargaison..
Avaterre :
côté d'une rive aménagée
pour le halage
des bateaux par les chevaux ou par un système de traction
mécanique (diesel sur pneus ou électrique sur
rails).
Voir "bord
d'hors".
Aveugler :
sur un bateau, obturer une voie d'eau accidentelle par une
réparation de fortune.
Aviron : rame fine et longue. Lorsqu'il est placé à l'arrière du bateau, c'est la "godille".
Autre
sens dérivé : sur les anciennes
péniches en bois, les mariniers nommaient "aviron" le safran
du gouvernail.
À voir : un très
beau site, et très complet,
consacré à tout ce qui touche l'aviron de
près ou de loin
Avis à la batellerie
: Informations données par le service de navigation sur les conditions
de navigation, dérogeant temporairement aux dispositions générales du
Réglement Général de Police d ela Navigation Intérieure (R.G.P.N.I.)
Avitailleur : bateau de petite taille (30 m de
long maximum), nerveux et manoeuvrant, spécialisé
dans le ravitaillement des bateaux, en marche ou à quai, en
carburant principalement, mais aussi en fuel domestique, huile de
vidange et même eau potable et gaz, ainsi qu'en autres
produits tels que peinture ou petit matériel. C'est en somme
une station service navigante qui va au-devant du client, service qui
devient malheureusement de plus en plus rare.
On peut faire
un avitailleur à partir d'un ancien bateau de commerce de
petite taille, du genre automoteur berrichon ou breton.
Le "Cher", petit berrichon qui travaillait sur Paris, en est un bon exemple,
comme
le
"Piranha" à Conflans-Sainte-Honorine.
Axiomètre : indicateur d'angle de gouvernail sous forme d'un cadran muni d'une aiguille ou flèche indiquant la position du safran. Il est placé devant le timonier et le macaron.