Façons :
formes rétrécies de l'avant et/ou de
l'arrière
d'un bateau, "façonnées" par ferronerie dans les bateaux métalliques,
ployées à l'eau chaude et au feu dans les anciennes coques en bois.
Un bateau sans façon
serait parfaitement rectangulaire en plan. Sur la péniche,
il n'y a pas de façons : le fond est réuni à la bordaille par
des arêtes vives, les cornières. Sur les coques en
fer, par les bouchains ou
les cornières. Par exemple, sur le luxmotor,
les formes effilées à l'avant et à l'arrière
sont les façons. Les
façons sont donc la partie arrondie et formée pour
assurer, à l'avant, une bonne pénétration dans
l'eau et, à l'arrière, une bonne arrivée d'eau
à l'hélice. Le "canadien" a
des façons ou formes réunies par les bouchains qui en font un
bateau bien façonné. L'exécution des façons est un poste lourd
dans la réfection du fond d'un bateau car elle demande beaucoup de travail :
mise en forme des pièces une par une à chaud puis mise en place de celles-ci.
Le coût de la seule exécution des façons peut équivaloir, voire dépasser
celui du reste du fond.
(merci Jean-Claude pour les précisions
!)
 .
.
Les
belles façons d'un automoteur de type "marocain" sur
le canal du Midi.
(Photo Bruno Bellemère)

D'autres
belles façons sur un automoteur Freycinet
Fanal
: grosse lanterne à pétrolen avec réflecteur onterne, servant à
éclairer l'avant du bateau et les berges. Ils servaient aussi à
éclairer l'intérieur des tunnels jusqu'à leur interdiction en 1936 pour
des raisons de sécurité.
Faraman :
sur le Rhône, cheval de droite dans la couble. On distingue le faraman de monture (devant) et le faraman de seguin (derrière).
Fardage : prise an vent d'une embarcation. Il est iportant sur un bateau vide (lège).
Fargues :
tôles en saillie anti-chute à l'avant du bateau,
prolongeant l'étrave en
hauteur. C'est généralement sur les fargues que le
marinier inscrit en gros la devise de
son bateau. En maritime, c'est le pavois.

Fargues
d'un bateau
chargé de secrets, amarré derrière un mur de
verdure, sur la face cachée de la vallée du Doubs...
(photo prise au bout d'un sentier étroit, aux portes de l'aube, quand
le flûtiste
joue
de
son
pipeau, par "Rickfloyd", qui, sans crainte et avec de grandes espérances,
aurait
souhaité que
les
proprios
soient
là un de ces jours et lui disent "Bienvenue dans notre machine !
Prends
donc un cigare !"...).
Jouons un peu : quels sont les titres de Pink Floyd plus ou moins évoqués dans cette légende à rallonge
?
Solution (placer le pointeur ici)
Faseiller : sur
la Loire et l'Allier, se dit d'une voile qui claque au vent comme un
drapeau.
Faucardage,
faucarder, faucardeur : le faucardage est l'équivalent
du fauchage, mais sous l'eau. On utilise pour cela un bateau spécialement équipé,
le faucardeur.
Fauconnier ou faux-quenier : sur une péniche ou un bâtard de forme flamande, le fauconnier est la plus grosse moustache.
C'est celle avec laquelle, en entrant dans une écluse ou en
passant sous un pont, si l'on ne peut éviter le heurt, il "faut
cogner". L'origine du mot est donc une déformation écrite de ces
mots.
Fausse-quille :
terme désignant un fort madrier horizontal
constitutif de la charpente de l'arrière à tableau d'un bateau.
La fausse-quille est en travers de la sole,
reçoit l'étambot et supporte
et protège
l'extrémité inférieure de la mèche du
gouvernail.
Femelle :
sur le lac Léman, timon de gouvernail d'un canot.
Fémelot : partie femelle
dans laquelle est introduit l'aiguillot (partie
mâle) de la penture (ferrure du gouvernail), l'ensemble formant un gond permettant
d'articuler le safran à la poupe ou au tableau
arrière.
Fermette :
structure métallique mobile, constitutive des premiers barrages mobiles,
notamment à aiguilles.
La fermette peut pivoter latéralement sur sa base pour se
coucher sur le radier.
Redressée et reliée à ses semblables, elle forme une sorte de
passerelle contre laquelle viennent s'appuyer les systèmes
de bouchure du barrage
: aiguilles (système Charles
Poirée), rideaux (système
Caméré) ou vannes coulissantes
(système Boulée). Ces systèmes, qui
ont rendu de grands services au XIXe siècle, sont
aujourd'hui dépassés et progressivement
remplacés par des clapets basculants automatiques. Le mot
est utilisé principalement au pluriel.

Fermettes
de barrage mobile sur la haute Seine (photo E.Berthault)
Fil de fer
: terme utilisé par dérision sans rapport avec le diamètre du câble en
question, qui peut être de plusieurs centimètres, voire dépasser le
décimètre comme sur les ponts suspendus.
Filadière :
petit bateau de pêche de la Gironde, à l'avant et l'arrière pointus,
et gréé à la livarde. Synonyme : lanche. Voir site.
Filet-barrage:
dispositif de pêche en Loire, qui consiste en un filet
placé en travers d'une partie du lit de la rivière.
Derrière le filet, le pêcheur est à poste dans
une toue
cabanée, et se déplace le long de celui-ci dans
une goume.
Filin : cordage en acier
Fintrelle :
corde de halage. Synonymes: verdon, maillette, grélin
(dans le Cotentin), ancierre.
Flanking : gouvernail de marche arrière monté sur les pousseurs. Ils sont au nombre de deux, un de chaque côté.
Flèche :
disposition de convoi couramment adoptée sur la Seine,
l'Oise, le canal du Nord... Généralement, ce sont
deux "freycinets" qui
se disposent ainsi, brêlés l'un
derrière l'autre, celui de l'arrière poussant le
premier, et l'ensemble se comportant comme un seul long bateau de 80 m
sur 5. Cela permet aux deux bateaux de porter une charge double de
celle d'un freycinet seul (soit au total 700 tonnes), tout en
consommant à peine plus qu'un seul, car la disposition en
flèche est d'un grand rendement hydrodynamique.
Flette
: barque étroite et
allongée,
généralement d'architecture marnoise (voir "marnois")
employée comme bateau de service et de charge sur la Seine
et ses affluents, jusqu'au début du XIXe siècle.
Fleuve :
de nos jours, les géographes décident qu'un
fleuve est un cours d'eau qui se jette dans la mer, en recevant sur
son cours des affluents, les rivières. Très arbitraire, cette
classification est très franco-française, et il n'en
fut pas toujours ainsi : jusqu'au XVIIIe siècle, la Loire,
la Seine, la Garonne, sont des rivières au même titre
que l'Yonne ou l'Allier, et on peut même trouver des textes
où un
fleuve se jette dans une rivière, comme par exemple dans
l'intitulé de la puissante corporation des mariniers de
Loire : la "Communauté des Marchands Fréquentant
la Rivière de Loyre et autres Fleuves Descendant en Ycelle".
Dire qu'un "fleuve" est un
cours d'eau qui se jette dans la mer est complètement arbitraire. Prenons
un exemple un peu extrême :
la Sèvre Nantaise descend des monts du sud du Massif Armoricain, et juste
avant de se jeter dans l'océan à Saint-Nazaire, reçoit sur sa rive droite
un autre cours d'eau, certes un peu plus gros, et qui s'appelle la Loire.
Car qu'est-ce qui m'empêche d'avancer que c'est la Sèvre Nantaise qui
est le "fleuve" et la Loire son affluent ? Certes, c'est exagéré parce
que là, ça se voit à l'oeil nu et sans avoir besoin de recourir à des
calculs de débits et de surface de bassin versant... Mais il y
a des cas plus litigieux qui remettent en question ce que l'on nous apprend
en CM2.
En effet, si l'on
admet comme définition de "fleuve" le cours d'eau
principal d'un bassin versant ouvert sur la mer, on va chambouler la
géographie telle qu'on nous l'a apprise à l'école primaire. En
effet, pour cela, il faut partir
de
l'embouchure
en mer et, remontant le cours d'eau, se demander à chaque confluent,
le cas échéant par des mesures précises, quel est
le cours principal, c'est à dire celui qui a 1. le plus fort débit,
2. le bassin versant le plus important. Prenons ce que nous appelons
la "Seine". En ce qui
concerne les confluents de la Risle, de l'Eure, de l'Epte, il n'y a pas
photo. La question se pose plus sérieusement à Conflans-Sainte-Honorine,
au confluent de l'Oise. Les mesures et l'oeil nu (qui peut cependant
être trompeur) nous indiquent que le cours principal est bien ce
que nous
nommons "Seine".
Un peu plus haut, passé Paris, la question se pose de nouveau
avec la Marne, avec la même réponse. Remontant plus haut
en ignorant l'Yerres, l'Orge, l'Essonne, voici le Loing. Là encore,
pas de problème. Un peu
plus haut, voici Montereau. Là, rien ne va plus : les mesures
(voir ci-dessous) nous donnent comme cours principal l'Yonne ! La "Seine" n'est
en fait qu'un affluent de l'Yonne. Et même pas : à Marcilly-sur-Seine,
les mesures nous apprennent de la même façon que de l'Aube
ou de la Seine, le cours principal est... l'Aube ! D'autant plus perturbant
que là nous ne sommes
plus dans l'arbitraire, mais dans le quantifiable, le mesurable.
Déterminer, de deux
cours d'eau, lequel est le principal et lequel est l'affluent, n'est
pas toujours simple, et, plus que de
considérations purement physiques telles que
débit, longueur et surface du bassin versant que l'on
était alors bien incapable de calculer, et dont en fait
on n'avait vraisemblablement pas grand chose à faire,
cette détermination
semble souvent provenir de considérations commerciales.
Ainsi, la Loire n'a gagné son
titre de fleuve au détriment
de l'Allier, pourtant presque aussi important, qu'au fait d'être
plus proche du Rhône, et de constituer avec lui et la Seine,
un axe commercial très important dès
l'Antiquité. C'est encore plus net dans le cas de la Seine
et de l'Yonne, cette dernière étant, à
leur confluent à Montereau, nettement plus importante que
le cours d'eau dont elle n'est officiellement que l'affluent,
alors que
leurs débits respectifs se répartissent comme
suit : à peine 80 m³/s pour la Seine et 92,7 m³/s
pour l'Yonne (le bassin versant de l'Yonne est également
plus étendu que celui de la Seine). Dans des cas aussi
litigieux, n'aurait-il pas été judicieux
de mélanger les deux noms pour en faire un troisième
? Ainsi La Loire et l'Allier formeraient "l'Alloire", et la Seine
et l'Yonne formeraient la "Syonne", ou "Seiyonne" [1].
Non ? Bon, ce que j'en disais...
Autres cas litigieux du même genre : le Loing et l'Ouanne - le Loing
est dans l'axe de la haute Loire vers la Seine (ou l'Yonne)
-, la Durance et la Clarée... On tend actuellement à distinguer
la Dordogne de la Garonne et de l'élever au statut de fleuve partageant
un estuaire commun avec un autre fleuve.

Le
confluent de la
Seine et de l'Yonne à Montereau. En bas, venant du sud, l'Yonne.
A droite, venant de l'est, la Seine. Et ce qui s'en va à
l'ouest, à gauche, vers Paris, qu'est-ce donc ? (Origine du
document : Géoportail)
[1] A
l'appui de cette idée, nous invoquons l'origine des deux noms,
qui est commune : Ica-Onna est devenue l'Yonne, tandis que la Seine
vient de Sequana, latinisation, selon certains linguistes, de
Is-Ica-Onna, que l'on peut traduire approximativement par "la rivière de
Ica-Onna" soit "la rivière qui se jette dans Ica-Onna".
Flottabilité
(réserve de-) : en canoë ou en kayak,
grande vessie en plastique gonflable, placée dans les pointes avant et arrière afin de
garantir
un minimum de flottabilité au bateau en cas de dessalage.
Synonyme : gonfle.
Flottable :
une rivière est dite flottable lorsqu'elle est
suffisamment aménagée pour que puissent y
descendre des bois flottés (voir "flottage").
Généralement, pour cela, les chaussées
de ses moulins sont équipées de pertuis.
La partie flottable d'une rivière commence assez
largement en amont de sa partie navigable, si elle en a une. Tout cela
est obsolète depuis la disparition de la pratique du
flottage en France (sauf dans le Marais Poitevin).
Flottage :
technique d'acheminement du bois par voie fluviale, qui consiste à assembler
ce bois en grands radeaux, les "trains de bois",
pouvant se diriger comme un bateau. Le fret est ainsi son propre moyen
de transport, ce qui serait plus difficile pour du plomb...
Très pratiqué autrefois sur de nombreuses
rivières (Durance, Loue, Arroux, Aube, Loire, Garonne, etc.)
il fut particulièrement actif sur l'Yonne et la Cure pour
alimenter Paris. Clamecy était alors la capitale de cette
industrie qui faisait vivre toute une population.
Le bois calibré en "moulées" de 1,14 m de long, et
marqué du "logo" de chaque marchand, arrivait là par la
technique du "flottage à bûches perdues", c'est à
dire que ces moulées étaient jetées à la
rivière dans les hauteurs du Morvan et du Nivernais, et
était guidé tout au long de son parcours par des ouvriers
postés sur les rives pour veiller à ce qu'aucune
bûche ne se perde dans les contre-courants et autres obstacles du
parcours. A Clamecy et dans d'autres ports proches
(Châtel-Censoir, Vermenton, Armes...), ce bois était
tiré à terre (le "tirage"), trié (le "tricage") et mis à sécher en grands "théâtres" avant d'être assemblé en
trains.
Les mariniers, nommés "flotteurs", qui
conduisaient ces derniers jusqu'à Paris étaient d'excellents navigateurs. Les
trains partaient groupés, à dates fixes, et
franchissaient les pertuis par éclusées synchronisées.
Une seule région en France
pratique encore, à l'échelle industrielle, le
flottage, c'est le Marais Poitevin.

Train de bois
flotté dans le Marais Poitevin en août
2008
Sur
le flottage en Morvan, lire ici et ici.
Flottaison (ligne de) :
ligne correspondant à l'intersection de la surface de l'eau calme
et
du flanc du bateau. Sa hauteur varie bien sûr en fonction de
la
charge du bateau, mais la ligne de flottaison de
référence est celle prise quand le bateau est
vide. Elle
délimite les oeuvres vives et
les oeuvres mortes.
Flotte : sur le bateau, pièce de renfort en forme de plaque, en chêne ou en fonte, servant à fixer les boulards par le dessous sur les veules.
Flotteur :
caisson ou compartiment étanche et rempli d'air ou de substance bien
plus
légère que l'eau (par exemple de la mousse de
polyuréthane ou du polystyrène
expansé),
fixé latéralement à un bateau ou
même
intégré dans sa structure, afin
d'améliorer sa
flottabilité et sa stabilité.
Autre sens : navigateur spécialisé dans la
conduite de trains de bois flottés (voir "flottage").
Floutayri :
Sur la Dordogne et l'Isle,
batelier, simple matelot.
Flurbanisation :
néologisme. Concept créé et
développé par l'historien Bernard Le Sueur pour
désigner le mouvement de regain
d'intérêt et consécutivement de retour
physique des populations citadines vers la voie d'eau amorcé
en France vers la fin des années 1970.
"Ce retour s'effectue avec des demandes qui sont celles de
"non-fluviaux" et celles-ci influencent directement
l'aménagement (en particulier touristique) du territoire",
précise Bernard Le Sueur, dont les travaux de recherches sur
le
monde fluvial et son histoire font autorité.
Flûte :
nom donné à plusieurs types de bateaux de canal
présentant en commun un certain élancement dans
les lignes. On distingue ainsi la flûte
de Bourgogne,
longue de 25 à 35 m et large de 3,50 m à 5 m, la
flûte de Saint-Dizier qui lui est très semblable,
la flûte
d'Ourcq longue de 28 m sur 3 (la demi flûte, deux
fois moins longue, existe aussi), et la flûte
de Berry,
de 27,50 m sur 2,60 m. Ces bateaux ont pour la plupart disparu,
mais quelques exemplaires de flûtes d'Ourcq et
du Berry existent
encore, en métal. On trouve l'orthographe "flutte" sur le Tarn.
Fluvial :
qualificatif qui s'applique à tout ce qui concerne l'eau douce qui coule,
même lentement. Les rivières, les canaux, les
fleuves
constituent le monde fluvial. Certains marais en font partie dans
une certaine mesure, comme le Marais Poitevin. En revanche, les
lacs
n'appartiennent pas au monde fluvial, mais lacustre.
Fluvio-maritime : bateau
automoteur de forts tonnage et gabarit, capable de naviguer
en mer aussi bien qu'en rivière. Un fluvio-maritime porte
généralement dans les 4000 tonnes, et on en
rencontre des exemplaires sur l'axe Saône-Rhône,
sur la Seine, l'Oise, le Rhin... On dit aussi "cargo".
Flying-bridge : sur les coches de plaisance,
poste de pilotage supplémentaire extérieur, placé
généralement sur le toit. Traduction littérale :
"pont volant", qui n'a pas
du tout la même signification en français !
Foirine :
voir "foraine" ci-après.
Foncet : ancien
bateau de charge de la basse Seine, en usage jusqu'au
début du XIXe siècle. Lacurne de Sainte-Pallaye
décrit certains de ces bateaux comme "excédant en
longueur les plus grands vaisseaux de l'océan, ayant
jusqu'à 27 toises (soit environ 50 m, NDA) entre chef et
quille". On trouve aussi ce mot sous les formes "fonsset", "fousset" ou
"fosset".
Fonçure : élément
de base constitutif de la sole.
C'est généralement une planche de la longueur du bateau.
Foraine
ou foirine : sur un moulin-bateau,
bateau latéral servant de flotteur-stabilisateur et de
soutien de la roue. Sur le Rhône, on appelle celà le chênard.
Forme ou forme de radoub
: grand bassin de mise à sec pouvant être vidé de son eau par des
pompes, pour la construction, la réparation, l'entretien et le carénage
des bateaux, ainsi que pour leur destruction. Plutôt maritime.
Fort :
sur un port, manoeuvre affecté au déchargement des pommes.
Fourche : fer de yeck en forme de fourche pour crocheter un filin ou autre cordage
Fraidieu :
sur le lac Léman, vent thermique frais qui soufle du nord, depuis la
région de l'Arve, entre Yvoire et Genève.
Franc-bord : une bordaille est
dite "assemblée à franc-bord"
(ou "francs-bords") lorsque chaque planche est jointe chant sur chant
à sa voisine en hauteur. C'est l'inverse de l'assemblage à clins.
Frégaté :
un bateau est dit "à flancs frégatés", ou tout
simplement "frégaté", lorsque ses flancs, au lieu
d'être verticaux ou évasés, sont au contraire
incurvés en se rapprochant vers le haut. Cette disposition est
particulièrement fréquente chez certaines pirogues monoxyles dans le but de rentabiliser au maximum le volume offert par l'arbre. C'est aussi le cas de plusieurs bateaux de l'Adour, comme le dragueur, le chalibardon et la tilhole.

Taille
dans un arbre d'une pirogue monoxyle frégatée
Freinte : différence de volume ou de poids considérée comme normale entre le départ et l'arrivée de la marchandise.
Fret : cargaison à transporter
Freteaux :
pièces de bois coudées pour la confection des
bateaux (terme lyonnais).
Freycinet (Charles
Saulce de -) (1828-1923) : ministre des Travaux
Publics sous la Troisième République qui,
à l'imitation de son prédécesseur Louis Becquey,
est à l'origine de la loi du 5
août 1879 visant à étendre et unifier
le réseau fluvial français, sur un gabarit
minimum plus grand (38,50 m sur 5,20 m, mouillage 2,20 m pour un tirant
d'eau de 1,80 m, hauteur libre 3,50 m) de manière
à ce que la France puisse recevoir sur ses canaux et
rivières les grands bateaux flamands, et notamment la "péniche
flamande"
ou "spits". Remarquons au passage que la veille-même, le 4
août 1879, une loi toute semblable était
votée en
Belgique. Le gabarit Freycinet, majoritaire en
France, est aujourd'hui considéré comme
dépassé. Par assimilation, le nom de Freycinet
est devenu un nom commun et désigne un bateau aux dimensions
de 38,50 m par 5,05 m, "calant" 1,80 m, et portant 250 tonnes en canal
et 350 en rivière profonde. C'est le bateau de canal le plus
courant.
Commencée dès le lendemain de la promulgation de
la loi
du 5 août 1879, la mise en application du programme de
Freycinet
s'est concentrée particulièrement sur les vingt
dernières années du XIXe siècle, mais
s'est
cependant étendue sur tout le suivant : le canal du Midi a
vu
certaines de ses écluses allongées dans les
années
1970-80, et l'unique écluse du canal de Pont-de-Vaux (bassin
de
la Saône) a été mise à ce
gabarit en 1994,
lors de la réhabilitation de ce canal.
Ce programme ne s'est cependant pas appliqué sur toutes les
voies d'eau françaises : toute la Bretagne, l'Anjou, le
Berry,
l'Occitanie, une partie du canal du Nivernais et une autre du canal
d'Orléans, entre autres, en ont été
écartés.
Au passage, on peut avoir de bonnes idées dans un domaine et de nettement
moins bonnes dans d'autres : Lors de l'Affaire Dreyfus, Freycinet a
pris la position des "Antis"...
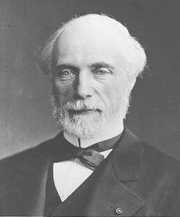
Charles Saulce de Freycinet (1828-1923)
Funiculaire :
se dit d'un procédé mécanique de traction ou
d'élévation qui fait usage de cables ou de fortes
cordes.
Ainsi le "zinzin" qui tractait les bateaux à
l'entrée des écluses du nord était un
système funiculaire. De même, certains ascenseurs à bateaux,
comme le plus haut, celui de Strépy-Thieu en
Hainaut,
sont funiculaires et contrebalancent le poids du bac empli d'eau
par des contrepoids. Quant aux plans
inclinés,
ils le
sont presque par nécessité.

L'ascenseur
funiculaire de Strépy-Thieu.
Fûtreau
(ou futereau, fustereau) : bateau
de Loire de taille modeste (autour de 6 à 8 mètres) et
d'usage
local, notamment pêche. Le futreau possède une
architecture semblable à celle du chaland
de Loire, mais en
plus
petit. Il est gréé d'une voile carrée
et
équipé d'une petite piautre comme
le chaland. On peut
dire que le fûtreau est au chaland ce que le dauphin est
à
la baleine. Le fûtreau partage vraisemblablement
avec le weidling du haut-Rhin et la zilla du
haut-Danube une origine celte commune, du temps des civilisations
de la Tène
et d'Halstatt, soit grosso modo le premier millénaire avant
notre ère.




