

 |
 |
||||
| M | ||
|
Macaron : équivalent
dans le bateau du volant de la voiture. On dit aussi "barre à roue". Macaron.
Autre sens : tracteur électrique sur berge Magistral (réseau) : voir "réseau" Mahon :
terme déniché dans des documents de la fin du
XVIIIe siècle par l'historienne de la Marine de Loire Françoise
de Person, et qui semble désigner un chaland
ligérien de petite ou moyenne taille, en quelque
sorte une toue. On peut rapprocher ce mot de "mahonne" ou "maonne" qui
désigne un bateau de charge turc. Il serait
emprunté, comme l'italien "maona", au mot turc
"mâoûna", peut-être lui-même
d'origine arabe.  Tenue de la manchette.
"Réséda", marie-salope de Troyes, sur le canal de la Haute-Seine, au début du XXe siècle.
Autre sens : se dit
d'un amarrage en trois points quand le bateau tracteur développe le
filin de son centre arrière vers deux points latéraux avant de la
remorque (le bateau tracté). On dit "remorque croisée" quand l'amarrage
se fait sur quatre points et est croisé.
Ancien marocain sur le canal du Midi
Marque(s) de crue : Marques portées sur les balises et les quais des rivières, et déterminant la possibilité ou non de naviguer en fonction de la hauteur des eaux. On distingue trois niveau : en marque I, petite crue, vigilance. En marque II, crue importante, restrictions de navigation, notamment arrêt des bateaux à passagers. En marque III, arrêt total de la navigation, on est en P.H.E.N.. Remarque : sur le Rhin, c'est arrêt de navigation dès la marque II. Voir le Réglement Particulier de Police de la Navigation.
Marque de crue sur la Saône (photo de Pierre Ydef) Marquise :
poste de pilotage d'un bateau. C'est le terme marinier pour désigner
la timonerie. Le
mascaret de Caudebec-en-Caux (gravure du XIXe) (Merci à Françoise Hébert) Maslingue : clé simple que le marinier fait en fin d'amarrage sur l'oreille du bollard, pour bloquer le bateau. Masses :
terme employé par les mariniers pour désigner
les musoirs, maçonneries d'écluse
qui se présentent frontalement devant leur bateau. Il n'est
pas impossible que le mot vienne de l'impression massive que donnent
ces musoirs quand on est montant, combiné à une
abréviation de "maçonnerie". Masses aval d'une écluse (canal de Roanne à Digoin). Les impressionnantes masses d'une écluse de haute chute (6 mètres) du même canal (Chassenard). Mât (petit) : Sur la péniche ou l'automoteur, pièce fixée aux denbords, à l'avant, sur laquelle est fixée la sauterelle. Sur les bateaux tractionnés, le tirage était frappé au sommet et permettait une conduite plus aisée que l'amarrage au boulard avant. Mât de charge : longue perche ou espars articulé au pied du mât de canal, et relié à son extrémité au sommet de celui-ci. Il peut servir de sauterelle. Matelin : Noeud de marinier formé par deux demi-clés. Universel en fluvial et efficace pour solutionner un amarrage rapide (autour d'un arbre par exemple). En mer, c'est le "noeud de cabestan" ou "à capeler". Il est nécessaire de savoir le faire pour avoir le permis fluvial. Noeud matelin Matelotage : Ensemble des actions et manoeuvres qui entrent dans le champ de compétences d'un matelot. Cela comprend bien sûr toutes les opérations d'amarrage et d'accouplement, mais aussi la conduite du bateau ou du convoi sous la direction du capitaine, ainsi que les communications par VHF, entre autres. Cela nécessite une excellente connaissance du matériel, de la voie d'eau et ses ouvrages, et de la réglementation. Mâtereau ou mâtrot : petit mât. Matériel : tout ce qui concerne le bateau et ses équipements, à l'exception du fret Le méandre fossile de Chevroches À l'aval de Dinan, un méandre fossile bien visible de la Rance (source Géoportail) Le méandre fossile bien visible du Pont d'Arc, sur l'Ardèche (source Géoportail)
Mèche : axe, le plus souvent vertical, du gouvernail. Sur la Loire, c'est la billette et elle est oblique, inclinée vers l'avant. 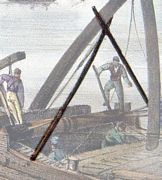 Ménicles.
Merlon : sur le Rhône, synonyme de "chevrette" ou de "digue". Mettre en tour : se faire inscrire au tour de rôle à la bourse d'affrêtement. Mettre un bout : placer un câble ou un cordage pour manoeuvrer. Mettre un bout dessus : se faire remorquer Mettre un travers : manoeuvre à l'aide d'un câble ou un cordage ammarré à terre Meublage
: dans l'appartement de la famille marinière, ensemble de l'ameublement
(armoires, couchettes, buffets, évier, etc.), qui est solidaire du
bateau (et, du coup, ne
se trouve plus tellement "meuble"). Seules la table et les chaises ne
sont pas solidaires du bateau. Fait sur mesure, le meublage est souvent
assez luxueux. Mignard : Dans son "Navigation intérieure" (éditions Berger-Levrault, 1957), qui est un abécédaire des mots techniques et administratifs de la batellerie, René Jenoudet donne au mot "mignard" cette définition : "dénomination courante des bateaux de dimensions inférieures à celles de la péniche de 38,50m : (automoteur et) barque du Midi, berrichon, flûte de l'Ourcq, etc...". Au chapitre "Bateaux affectés aux transports de marchandises" il est précisé : "Les petits bateaux ou mignards - Cette catégorie comprend des bateaux de types assez divers, d'une longueur inférieure à 34m mais d'un tonnage à l'enfoncement maximum supérieur à 60 tonnes. Ils circulent sur les voies navigables qui ne sont pas au gabarit des voies de première catégorie du plan Freycinet. (...) D'après les statistiques établies par l'Office National de la Navigation, la catégorie des petits bateaux groupe environ 1500 unités totalisant 200 000 tonnes. Un grand nombre d'entre elles sont vétustes et ne participent plus aux transports par eau. Cette catégorie compte néanmoins 450 automoteurs et 700 unités de construction postérieure à 1920 "
Mignole : bateau de
charge originaire de la Meuse,
reconnaissable à ses levées avant et
arrière
très prononcées, en lieu et place de
l'étrave et
de la poupe classiques de la péniche flamande, et qui lui
donnent une belle silhouette bien caractéristique.
Généralement de gabarit Freycinet, la mignole est
devenue
rare. On dit aussi "ardennais" , "meusan", "herna" ou "sambresse".
Miolle : grande
barque de la Garonne. Ne pas confondre avec la "mignole" (voir
ci-dessus).
Mise à l'eau d'une pirogue monoxyle construite en 1999 et 2000 à Nemours dans le cadre d'une étude d'archéologie expérimentale conduite par le GRAS. A l'avant du bateau, l'auteur de ces lignes, qui n'en mène pas large malgré son habitude de la pagaie simple : nous sommes à la Toussaint et le Loing est en petite crue ! (Photo tirée du site d'Hommes et Cours d'Eau)
Montant : bateau qui monte le canal ou la rivière (vers la source ou le bief de partage).. On parle aussi d'"écluse montante". Il s'agit simplement d'une écluse ordinaire que l'on franchit dans le sens montant. Monte-et-baisse : système qui permet, au moyen d'un petit treuil embarqué, de régler la profondeur d'immersion de l'hélice d'un bateau selon qu'il est lège ou chargé. Ce serait une invention, dans les années 1920, du chantier Quille et Merville constructeur du Nord, ou bien d'un marinier berrichon, Jules Beaune, qui fit monter ce système sur son "Nullité" en 1927. L'hélice est montée au bout d'un arbre de 1,20 à 1,50 mètre, selon la taille du bateau, fixé sur un cardan à la sortie de l'étambot. Ce système performant et pratique, en plus de pittoresque, était néanmoins trop fragile pour des puissances supérieures à 80 CV. Un bateau équipé d'une moto-godille est assuré de ne pas passer inaperçu, du moins des mariniers et des amoureux et connaisseurs de la chose nautique. (Voir moto-godille plus bas).
Monte-et-baisse d'un automoteur berrichon, l'ancien "Nullité" mentionné dans le texte Monter :
se diriger vers l'amont de la voie d'eau.
Sur le lac Léman, se diriger vers l'est, vers Bouveret. Moraillon (vanne) : vanne de remplissage et vidange d'écluse, aussi appelée "vanne cylindrique", inventée par l'ingénieur Moraillon en 1884. La vanne est un large cylindre (environ 1,50 m de diamètre) qui s'escamote verticalement dans une cloche fixe qui la surmonte. Son principe repose sur le fait que la pression exercée sur les parois verticales d'un cylindre s'annulent, ce qui supprime l'inconvénient des vannes classiques qui, au-delà d'une certaine hauteur d'eau, ne peuvent plus bouger car plaquées par la pression de l'eau. La vanne Moraillon équipe avec succès de nombreuses écluses dont la chute dépasse quatre mètres.
Schéma
de principe de la vanne Moraillon. (Notions de Navigation Intérieure,
par E.Fourrey, 1946) Morée : sur la Saône, plage de sable. Morget :
sur le lac Léman, brise nocturne de la région de Morges.
Moto-godille montée sur un berrichon en bois, "Sancerrois". Photo des années 1970, collection Guy Matignon. Motopompe : pompe à moteur thermique (généralement essence) employée pour ballaster ou assécher Motor-boat : Narrow-boat motorisé. Dans la batellerie britannique, le marinier possède souvent deux narrow-boats qui naviguent l'un remorquant l'autre dans les canaux étroits, ou à couple dans les rivières et canaux larges. Dans les deux cas, il suffit qu'un seul des bateaux soit motorisé, c'est le "motor-boat", et l'autre est le "butty" (de "buddy", compagnon). Signification : "bateau à moteur", tout simplement. Moufle : ensemble de deux poulies avec crochet permettat de démultiplier les froces pour soulever ou tracter. Les poulies peuvent être à plusieurs réas (gorges) afin d'augmenter la démultiplication et de réduire l'effort à fournir. Mouillage : profondeur d'eau disponible (et non pas amarrage comme en maritime). Détermine le tirant d'eau maximal autorisé. Il peut être un peu augmenté momentanément en "gonflant" le bief (sur demande). Mouille : expression marinière pour signifier que la profondeur est suffisante : "Tu peux y aller, y'a de la mouille le long de cette rive !". Presque synonyme de "mouillage". Autre sens : état d'une marchandise détériorée par l'eau. Particulièrement délicat lorsque ces marchandises sont du sucre ou des denrées alimentaires en vrac. Moulin à eau : établissement à caractère artisanal et/ou industriel établi sur une rivière ou une anse maritime (dans le cas particulier du moulin à marée) pour en exploiter la force motrice. Rappelons qu'un moulin (à eau ou autre) ne sert pas forcément à faire de la farine, mais peut être une forge ou une taillanderie (la force hydraulique actionne les soufflets et les martinets), une scierie (elle actionne les scies), une tannerie, une pompe à eau... On parlait autrefois d'"usine", "moulin" étant plutôt réservé aux usines équipées de meules à broyer le blé, les noix... Sans trop entrer dans les détails, un moulin à eau comprend son bâtiment proprement dit et sa roue (verticale ou, c'est plus rare, horizontale), ainsi que bien souvent une digue créant une retenue de réserve d'eau sur la rivière, et un ou des vannages qui permettent de règler et contrôler le débit de l'eau envoyé dans la roue, et de celle qui n'est pas utilisée. C'est le problème du franchissement de la digue par les bateaux qui va amener progressivement l'invention de l'écluse à sas. Site de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins Moulin-bateau ou moulin-nef : établissement de meunerie flottant et mobile. L'intérêt est de pouvoir placer ce moulin dans la meilleure veine d'eau, souvent sous un pont. Le problème surgit inévitablement quand cette bonne veine d'eau est également utilisée par la batellerie. Le moulin-nef est comparable au bateau à roues à aubes, dont il est l'exact opposé : ce dernier a sa propre énergie à bord, et s'en sert pour se mouvoir sur l'eau, alors que le moulin-bateau, statique, récupère l'énergie du courant pour l'exploiter à son bord. Les moulins-bateaux, innombrables autrefois sur les rivières, ont disparu au cours du XIXe siècle. La Grande Encyclopédie de Diderot et D'Alembert en présente un modèle dans son chapitre "L'Art de Charpenterie". Site de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins Moulin pendu : moulin fixe en maçonnerie et charpente, dont la hauteur de la roue peut varier pour s'adapter, par un système d'engrenages, au niveau de la rivière. Site de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins Moustaches : fortes protections en métal (autrefois en bois), ou en plastique rembourré de caoutchouc, fixées sur les points les plus vulnérables du bateau (côtés avant et arrière).  Moustaches à l'avant d'une péniche (maquette). Moutio : sur la Saône, haut-fond sablonneux émergeant à la baisse du niveau de l'eau Mur de chute : haute contre-marche située dans la partie amont du sas, reliant le radier du busc au radier du sas. Muraille : partie verticale de la coque entre les bouchains ou les cornières et le plat-bord. Synonyme : bordaille Musel : sur le courpet de la haute Dordogne, pièce de bois triangulaire placée aux pointes avant et arrière pour maintenir ensemble, par cloutage ou chevillage sur elle, les extrémités des bordés et de la sole. Musiau : cordage court attaché sur le milieu de la maillette et à un boulard avant, permettant de relâcher ou donner du mou pour aider à maintenir le bateau dans une direction donnée, mais aussi à ramasser la maillette (corde de tirage) Musoir : maçonneries des têtes d'écluse, qui se présentent frontalement au bateau. Synonyme : masses. Musoir amont d'une écluse (canal du Nivernais). |
||
| Accès direct à la carte de France des voies navigables | ||||
| Lexique fluvial et batelier |
Les rivières et les canaux | M'écrire | ||
| Pensez à visiter le (modeste) rayon librairie, conférences et animations.... | ...et les niouzes ! | |||
|
| ||||
| Retrouvez les bateaux fluviaux de France dans le CDrom "Bateaux des Rivières et Canaux de France", version très enrichie (plus de textes, plus d'illustrations, et même quelques bateaux supplémentaires) du département "Bateaux" du présent site, édité par l'association HiPaRiCa. Voir la présentation et la commande ici et ici. | ||||