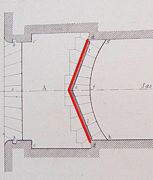Bâbord, tribord : gauche et droite, en
parlant exclusivement du bateau (maritime mais toléré en fluvial). Pour
la rivière ou le canal, on emploie les termes de gauche et droite, pour
désigner les rives par exemple.
Bac : bateau
assurant au public (personnes, animaux et véhicules) la traversée d'une
rivière, d'un bras de rivière, d'un fleuve ou d'un bras de mer en
l'absence de pont. De nos jours, la plupart des quelques bacs qui
subsistent encore là où un pont ne les a pas rendus inutiles, sont
motorisés. On en trouve dans l'estuaire de la Loire, celui de la
Gironde, dans le delta du Rhône, sur la Seine et le Rhin, et très
localement sur d'autres rivières. Dans le Marais Poitevin, les bateaux
à chaines sont des bacs en libre service.
Autre sens dérivé :
manoeuvre en canoë
ou kayak,
consistant à traverser une rivière ou une veine d'eau rapide, en
plaçant le bateau face au courant avec un léger angle ainsi qu'une
certaine gîte
côté aval, de manière à utiliser l'incidence du courant sur la coque
pour déplacer transversalement le bateau, comme dans le cas d'un bac à
passagers.
Bac à
traille
: bac relié à un cable disposé transversalement à la rivière et
coulissant le long de celui-ci. Ce cable est placé à une certaine
hauteur par rapport à la surface de l'eau, selon que la rivière est
navigable ou non. Pour se déplacer le long de ce cable, le bac se place
en oblique par rapport au courant, en lui présentant son flanc. C'est
l'incidence du plan vertical de ce flanc par rapport au courant qui
crée une force tranversale lui permettant de se déplacer latéralement.
Il peut y avoir aussi un deuxième cable transversal sur lequel le bac
se hale
à la force humaine ou grâce à un treuil. On peut voir encore de tels
bacs sur le Cher, non loin de Chenonceaux, sur la Cure à Voutenay, ou
encore sur la Risle en amont de Pont-Audemer, et certainement en
d'autres lieux. La Grande Encyclopédie de Diderot et D'Alembert en
présente une modèle (chapitre "L'Art de Charpenterie").
Bac
pendulaire
: bac relié par un cable fixé très en amont à un point fixe au fond de
la rivière ou sur une rive. Ce cable, d'une longueur supérieure à deux
fois la largeur de la rivière, est soutenu hors de l'eau par des
batelets espacés régulièrement. Il peut éventuellement être signalé par
des
bouées. Comme le bac à traille, le bac pendulaire se déplace
latéralement en utilisant l'incidence du courant sur un de ses flancs
ou sur un ou deux safrans. Il n'occasionne pas une gêne aussi grande
pour la navigation. On voit ce type d'équipement présenté sous le nom
de "pont
volant" dans la Grande Encyclopédie de Diderot et D'Alembert
(chapitre "L'Art de Charpenterie"). Il y en avait un à l'aval du moulin
de Ballan sur le Cher en aval de Tours.
Bachet : ancien bateau de charge du bas Adour,
d'origine et d'architecture plus maritimes que fluviales. Le bachet
possède
étrave, quille et étambot et mesure de 12
à 18 m. Il est gréé au tiers.
Bâche ou bêche : ancien bateau de la Saône,
dépourvu de gouvernail, et manoeuvré à l'aide de deux avirons, l'un à
l'avant, le picon, et l'autre à l'arrière, l'empeinte. La bâche,
construite jusqu'au milieu du XXe siècle, mesure de 15 à 24 m de long
sur 3,50 m à 4,20 m de large, et peut porter de 40
à 100 tonnes.
Autre sens : sur un pont-canal,
la bâche (mais non la bêche) est la partie de l'ouvrage où est retenue
l'eau. On dit aussi cuvette ou cunette. La bâche du pont-canal de
Briare, fabriquée par les établissements Daydé et Pillé de Creil [1],
est métallique.
Bachot : petite barque dont la présence est
obligatoire sur les bâtiments.
Équivalent fluvial de l'annexe maritime. Synonyme : batelet.
Bacouni : sur le lac Léman,
batelier (eu usage seulement sur la rive nord et à Genève).
Bacop : barque
utilisée dans les Flandres,
et notamment dans les marais de Saint-Omer. Le guinot est un bateau de canal dont
la forme est issue du bacop.
Bacteux, baqueteux
: dans le nord de la France : charpentier de bateaux.
Bâcu
: petite courbe individuelle par cheval reliée à la courbe pour les attelages doubles sur laquelle est est attaché le verdon de halage
Baile : sur le Rhône, charretier qui dirige
l'attelage de chevaux de halage, nettement plus important que sur le
canal où il n'y a pas à lutter contre le courant.
Baisser : sur la Loire, descendre avec le
courant. Synonyme : avaler.
Baissier ou bassier : haut-fond de gravier
formant un seuil naturel en pente très douce. N'offrant qu'un mouillage
faible, un baissier limite le tirant d'eau du bateau.
Bajoyer :
paroi latérale de l'écluse ou du pertuis. Egalement face
interne d'une pile de pont (les autres parties sont l'avant-bec et l'arrière-bec).
Etymologie
: ancien français bas jouyer (de joue).

Bajoyer
gauche de l'écluse de Roanne.
Bal (ou balle) : "aller à bal(le)" ou "mettre
à bal(le)"
signifie virer le gouvernail jusqu'en bout de course, à la
perpendiculaire de l'axe du bateau, que ce soit à la barre
franche, auquel cas on est
en surplomb au-dessus de l'eau, ou au macaron,
ce qui est plus tranquille. C'est nécessaire pour
éviter de poser le safran
sur le radier
du busc lorsque l'on est avalant.
On peut entendre un marinier dire "De bal à bal, j'ai trente
tours de macaron",
ce qui signifie que pour virer son gouvernail d'une
extrémité à l'autre de sa course, il
doit faire faire trente tours à sa barre à roue,
ce qui est assez courant sur les bateaux de commerce.
Balade-couillons
:
terme pas vraiment officiel mais un chouïa
méprisant par lequel les mariniers et les agents de la
navigation désignent un bateau de transport de passagers
à usage touristique, un bateau-mouche par
exemple. Synonyme : promène-couillons. Terme officiel : bateau
à passagers.
Balage
:
dans le nord, sorte de large toboggan ou glissière destiné à diriger
le charbon dans la cale du bateau lors de son remplissage depuis un
wagonnet.
On dit aussi "rivage".
Balancier : voir "volée".

Porte amont de l'écluse de Faguin
(La Guerche) sur le canal de Berry. Le balancier est bien visible.
Balayures :
résidus de chargement que le marinier
récupère en balayant l'houle
(ou oule).
Balisage :
ensemble des signaux fixes ou flottants servant à
délimiter le chenal en rivière.
Balise
: dispositif
fixe ou flottant,
placé sur la rivière pour délimiter le
chenal, signaler un danger, etc. On doit les respecter scrupuleusement.
Dans l'ancienne marine de Loire, on distinguait les balises de galerne,
délimitant le côté droit du chenal, et
les balises de mar, qui délimitaient le
côté gauche. C'était de simples longs
bâtons plantés dans le lit de la
rivière, et pour les différencier entre elles, on
sectionnait à moitié la tête des
balises de mar, qui pendouillait ainsi sur le côté.

Balise
sur
la Loire, à Châtillon/Loire.
Baliveau : sur la Loire synonyme
de "balise", piquet indiquant le chenal.
Ballast, ballaster : un commerce vide, pour pouvoir
passer sous les ponts des canaux, doit être ballasté
à l'arrière. Pour ce faire, on introduit de l'eau dans un compartiment
étanche prévu pour cela, ou bien dans la cale elle-même. On videra
cette eau par pompage. On peut aussi ballaster le bateau avec des
gravats dans la cale.
Balme : expression géographique et régionale
(région lyonnaise) qui désigne une côte peu élevée, mais abrupte et
escarpée. Ainsi appelle-t-on à Lyon "Balmes du Rhône" le quartier saint
Clair et son prolongement, et "Balmes de la Saône" l'ancien quai des
Etroits, dit aujourd'hui de Jean-Jacques Rousseau.
Ce mot balme vient du mot latin balma, grotte, et
par extension escarpement dans lequel s'ouvre une grotte, côte
escarpée, élévation. On le retrouve à peine déformé dans baume
en Franche-Comté.
Sur
la Saône, l'expression "à pleine balme" désigne l'état de la rivière
juste avant son débordement en lit majeur.
Bande : synonyme de "gîte".
Banquette : chemin de halage
maçonné sous certains ouvrages comme ponts et voûtes, et sur les
ponts-canaux. On peut préciser "banquette de halage".
Synonyme : "marchepied".

Banquette
du tunnel de la Collancelle (canal du Nivernais).
Baquet de Charleroi
: ancien
bateau de
transport,
devenu très rare, aux dimensions adaptées
à la navigation sur l'ancien canal de Charleroi à
Bruxelles, au gabarit réduit. Le baquet mesurait 19,50 m sur
2,60 m, ce qui permettait, en l'allongeant de 8 mètres, d'en
faire un berrichon
en France. Il en reste très peu.
Le baquet de
Charleroi, dans sa forme originelle en bois (années 1830),
ressemble beaucoup à une bélandre
flamande
de petit gabarit, avec quelques éléments
caractéristiques du tjalk
hollandais,
ce qui n'est guère étonnant,
bélandre et tjalk appartenant eux-mêmes
à la même famille morphologique. On dit aussi
"sabot" de Charleroi.
Baquet
d'Arras
: ancien
bateau de transport des
Flandres, originaire de la Scarpe.
Baquêterie
: chantier de construction
de bateaux, dans le Nord.
Baqueteux
: constructeur de bateaux, dans le
Nord.
Barbotin :
sur un treuil d'ancre, couronne en fonte moulée, sorte de
poulie crantée dans laquelle s'engagent les maillons de la
chaîne de façon à ce qu'elle ne glisse
pas.

Barbotin
Barcot ou barquot : sur le Rhône, barque.
Barge
: embarcation de charge
dépourvue de moteur et d'habitation, et utilisée de nos jours
généralement en convoi poussé. On peut la motoriser avec un Schottel.
Barnayout : bâton de marine spécialemnt utilisé
pour le bournayage.
Terme en usage sur la Saône.
Barne : sur la Loire, petite voile de temps fort.
Barque :
pas forcément un petit bateau ! Sur le canal du Midi et
le bas
Rhône, c'est un bateau de charge assez important, mesurant
jusqu'à 30 mètres. Sur le lac
Léman également, où elle est gréée de voiles latines.
Barquier :
dans le sud de la France, et notamment sur le canal du Midi,
équivalent de batelier.
Barrage : ouvrage placé en travers d'une rivière
pour alimenter un moulin de façon constante, et/ou pour maintenir un mouillage
suffisant pour assurer la navigation. Dans ce dernier cas, il est
équipé soit d'un pertuis à bateaux, soit d'un bassin
à portes marinières
(jusqu'au XIXe siècle), soit d'une écluse
à sas (à partir du XVIe siècle).
Barrage
(pêche au)
: voir "Filet-barrage".
Barrage
éclusé
: barrage placé sur une rivière pour assurer un mouillage
suffisant pour la navigation, et équipé latéralement d'une écluse pour
permettre son franchissement.
Barrage fixe
: barrage en maçonnerie, immuable.
Barrage
flottant
: Système employé par les services de navigation ou les pompiers pour
circonscrire une pollution flottante (hydrocarbures le plus souvent).
Cela consiste en un long chapelet de bouées contiguës avec lequel on
"enveloppe" la nappe polluante, ce qui permet de la récupérer.
Barrage
mobile
: un tel barrage ne se promène pas (!), mais il peut s'effacer
partiellement ou complètement en cas de crue, de manière
à ne pas inonder les terrains en amont. Tant que l'eau n'a pas atteint
sa limite de P.H.E.N., la navigation peut
s'effectuer en passant par dessus le barrage couché. L'invention en est
due à l'ingénieur Charles
Poirée en 1834, qui
s'est pour cela inspiré des anciens pertuis, et a transposé le
système sur la largeur de la rivière entière. D'autres systèmes sont
venus par la suite améliorer le principe. Le barrage mobile a permis un
essor considérable à la navigation fluviale à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle, sur les grandes rivières de plaine comme la
Seine, l'Oise,
la Marne, l'Yonne, la Moselle, la Saône..
Voir aussi :
Aubert,
Boulée,
Caméré,
Chanoine,
Dérôme,
Desfontaines,
Pasqueau,
Poirée,
Stoney,
Vanne-toit,
Wagon.

Barrage
mobile à aiguilles, système Poirée, sur le
Cher.
Lien
: sur le site
des Amis du Cher canalisé, le principe et des
photos de barrage à aiguilles
Barrage
réservoir : barrage établi sur un ruisseau ou
une rivière afin d'en exploiter une partie de l'eau pour alimenter un
canal, en acheminant celle-ci par des rigoles.
Barragiste : personne préposée à
la manoeuvre et
à la gestion hydraulique d'un barrage mobile dont elle a la
responsabilité. Le barragiste est un agent de
l'État (voir Direction
Départementale de
l'Équipement), et son travail requiert une grande
vigilance et tout autant de disponibilité. Sa
tâche est à présent
facilitée cependant par tous les systèmes
d'automatismes et de commande-supervision à distance.
N'empèche que cela reste un travail à lourde
responsabilité.
Barre
: système de gouverne d'un
bateau. Elle peut être "franche" ou "à roue".
Autre sens : dans les anciens pertuis, longue et forte poutre
transversale et pivotante, contre laquelle s'appuie le
système démontable d'obturation de la porte
marinière. Synonymes : barreau, chapeau, volée.
Barre à roue : système de
gouverne, dans lequel le pilote agit sur le safran par
l'intermédiaire d'un volant, le macaron,
et d'un système de transmission à
câbles, chaînes, mécanique ou
hydraulique. Permet de piloter à l'abri dans une marquise.
Barre
franche
:
système de gouverne, dans lequel le pilote agit
directement sur le safran
par
l'intermédiaire d'un timon.
Délicieusement rétro, physique et exempt de tout
risque de panne.
Barre
renversée (ou inversée) :
système de gouverne avec barre à roue, mais où celle-ci
doit être manoeuvrée
dans le sens inverse (on la tourne dans le sens horaire pour
aller
à
gauche,
et
inversement). Très perturbant quand on n'a pas l'habitude.
Barricaire :
sur la Dordogne
et l'Isle,
charpentier spécialisé dans la tonnellerie et la marine.
Barreau : dans la
terminologie des anciens pertuis, synonyme de barre, chapeau,
volée, brize.
Autre sens : sur les bateaux de
Loire, madrier horizontal qui renforce le safran de
la piautre
(l'"empannon")
à mi-hauteur
de celui-ci.
Barrots : cornières qui soutiennent en renfort
le dessous du rouf.
En canoë, un
barrot constitue le siège plus que rudimentaire du canoëiste.
Bascule
: bateau à vivier
spécialement aménagé pour le transport
du poisson vivant. Pour ce faire, une partie du bateau est
cloisonnée, et sa coque y est percée de trous
permettant au vivier ainsi formé d'être
constamment alimenté par l'eau de la rivière.
Synonymes : basoule ou basouille, huchet (en Lyonnais).
Basculer
(ou retourner) une écluse :
voir "Bassinée".
Bassin : dans à peu près
toutes les régions, le mot
"bassin" apparaît pour désigner un port ou une
gare d'eau. Exemples : le "Grand Bassin" de Castelnaudary, le bassin de
l'Oudan à Roanne, le "Bassin Rond" dans le Nord.
Bassin à portes
marinières :
ouvrage intermédiaire entre le pertuis
archaïque
et l'écluse
à sas moderne, qui se compose d'un bassin fermé,
en amont et en aval, par deux pertuis. On en voit encore de
très beaux vestiges bien conservés sur le Thouet
en Maine-et-Loire (Communes
de Montreuil-Bellay et Le Coudray-Macouard), et la Lawe
dans
le Nord (commune de La
Gorgue). Les documents de l'ingénieur Régemorte,
chargé, en 1749, de moderniser la rivière Ourcq,
en montrent de
très beaux plans aquarellés. Ces vestiges sont
d'un très grand intérêt
archéologique.
Synonymes (néologismes)
: archéo-écluse,
paléo-écluse

Bassin à
portes marinières de la Salle, sur le
Thouet. (Photo Jacques Sigot)

Bassin à
portes marinières de Bron, sur le Thouet.
(Photo Jacques Sigot)
Pour
en savoir plus sur les bassins à portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse".
(cliquer sur le titre)
Bassin
d'épargne : grand bassin placé latéralement à
une écluse, et destiné à en recevoir une partie de l'eau lors d'une bassinée
avalante, au lieu que celle-ci soit évacuée dans le bief aval. Cela permet de récupérér
cette eau pour une bassinée suivante montante, et de réaliser de
notables économies dans la consomation en eau de l'ouvrage. Il peut y
avoir plusieurs bassins d'épargne pour une seule écluse, placés en
étages à des altitudes différentes : plus ils sont nombreux, plus
l'économie est importante. Mais la mise en oeuvre d'une telle
disposition est assez coûteuse elle-même, et demande un grand espace.
Ce dispositif présente un intérêt certain sur les canaux
de jonction à
bief de partage et sur certaines portions de canaux
latéraux où les écluses sont hautes et très rapprochées. En
revanche, il n'en présente aucun sur les rivières
canalisées où l'eau ne manque quasiment que lors des périodes
de grandes sécheresses, et encore...
(Voir ce très
intéressant site : https://www.canal-math.com/ecluses-bassins-depargne/)

Ecluse
avec
bassins d'épargne.
Bassin
versant : le bassin versant d'une
rivière est l'ensemble des territoires tel que l'eau de pluie
qu'ils reçoivent se retrouve par ruissellement et
infiltration, plus ou moins directement, mais
inéluctablement, dans cette rivière. Les bassins
versants sont séparés l'un de l'autre par une
ligne imaginaire qui correspond souvent à une
crête de collines ou de montagnes, et qu'on peut comparer au
faîte d'un toit, les gouttières
représentant les rivières. Cette ligne s'appelle
"ligne de partage des eaux". Le bassin versant d'un fleuve est
constitué de l'addition des bassins de tous ses affluents,
en plus du sien propre avant son premier confluent. Lorsque trois
bassins versants se rencontrent, on a un "point
de partage des eaux". Ainsi
en France, les principaux points de partage des eaux sont-ils l'un vers
Langres, à la rencontre des bassins du Rhin, de la Seine et
du Rhône, un second à côté de
Pouilly-en-Auxois, à la rencontre des bassins de la Seine,
de la Loire et du Rhône, et le troisième vers
Langogne, à la rencontre des bassins de la Garonne, de la
Loire et du Rhône.

Les
grands bassins
versants de France.
(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)
Bassinée : volume d'eau consommé par un sassement.
Avec ou sans bateau, elle est toujours égale aux dimensions
horizontales du sas multipliées par sa hauteur de chute.
On désigne aussi par "bassinée" le nombre de
bateaux
sassés en même temps dans une écluse.
On dit par
exemple "une bassinée de quatre bateaux". Enfin, cela peut
désigner un passage de bateau dans une écluse,
auquel cas
ce terme devient synonyme de sassement.
Le terme "fausse
bassinée" désigne un remplissage ou une vidange
de l'écluse, sans qu'il y ait un bateau dedans. C'est le
plus souvent pour la préparer pour un bateau, alors qu'elle
était prête dans l'autre sens. On dit alors
"basculer, ou retourner l'écluse".
Voir
une bassinée
montante.
Voir
une bassinée
avalante.
Batai : barque
du Marais Poitevin.
Bâtard
du
Nivernais : bateau
conçu sur le modèle
de la péniche
flamande ou de la flûte
bourguignonne, mais à une longueur
inférieure, 30 mètres, de manière
à pouvoir travailler sur la partie centrale du canal
du Nivernais (de
Cercy-la-Tour à Sardy-lès-Épiry), qui
est restée au gabarit Becquey,
et n'a jamais été portée au gabarit Freycinet.
Bâtardeau (ou batardeau) :
dispositif provisoire
destiné à isoler de façon
étanche un ouvrage d'art ou tout ou partie d'un bief pour
l'assécher en vue de travaux de réparation. Le
procédé le plus courant consiste à empiler les uns sur les
autres
des madriers horizontaux, les "tampes",
dans des rainures verticales ménagées
à cet effet dans les maçonneries de l'ouvrage
(tête d'écluse ou pont le plus souvent), les "coulisses".
Bateau
: pour le marinier, bateau de commerce,
péniche, automoteur.
Le marinier emploie rarement le terme
de "péniche". Usage recommandé en toutes
circonstances, ne serait-ce que pour éviter de dire n'importe quoi
(nommer
"péniche" un coche
de plaisance par exemple).
Le bateau, c'est tout ce qui flotte et peut se mouvoir (par opposition
à l'établissement
flottant qui
est statique)
en portant au minimum une personne et éventuellement
(souvent même) du matériel : fret, bagages, habitation... On peut
nommer "bateau" aussi bien le minuscule acon
des boucholeurs et ostreiculteurs
que le plus gros des super-tankers. Comme le marinier, le kayakiste et
le canoëiste
parlent plus volontiers de bateau que de kayak
ou canoë.
Le bateau est le véhicule qui présente
la plus large palette de formes et de tailles, du kayak monoplace de
surf au
gigantesque porte-avions. En outre, il est le moyen de transport le
plus économique hormis la marche et le vélo.
Pour
apprendre aux enfants le riche univers des bateaux fluviaux, voir
l'ouvrage "Kevin
et Gwendo vont en bateau ". (cliquer
sur le titre)
Bateau à
chaînes
: sorte de bac
en libre-service
assez répandu dans le Marais Poitevin et le Marais Audomarois, où ils
permettent l'économie de coûteuses passerelles. Un système de bateau à
chaînes est composé d'une barque de taille variable selon l'endroit,
reliée par ses deux extrémités aux deux berges de la rivière par une
chaîne de longueur égale à la largeur de la-dite rivière. Si le bateau
est de l'autre côté quand il arrive, l'usager n'a qu'à tirer sur la
chaîne fixée à terre de son côté, et haler le bateau jusqu'à
lui. Une fois monté à bord, il se hale au moyen de l'autre chaîne,
jusqu'à l'autre rive. Ce système donne entière satisfaction à tous, et
a tendance à se développer dans cette région éminemment touristique.
Bateau
à passagers
: bateau spécialisé
dans le transport de personnes, dans un but essentiellement
touristique. C'est en quelque sorte la version moderne de
loisirs des anciens coches d'eau.
Sous cette appellation on trouve aussi bien le petit bateau d'un
dizaine de mètres qui transporte une douzaine de touristes pendant une
mini-croisière d'une heure ou deux, que le paquebot fluvial qui dépasse
100 mètres, aménagé comme un hôtel pour recevoir plusieurs dizaines de
passagers pendant une semaine ou plus. Les célèbres bateaux-mouche
sont des bateaux à passagers. Ce peut être aussi un ancien
bateau de commerce aménagé en restaurant naviguant ou en
hôtel.
Un permis spécial est requis pour piloter un bateau à passagers.
Bateau
d'intérêt patrimonial
: bateau qui a reçu ce label de la Fondation
du Patrimoine Maritime et Fluvial
en raison de critères définis comme sa technique de construction, son
âge, certaines spécificités mécaniques, la personnalité de son
propriétaire, etc. Très peu de bateaux fluviaux ont à ce jour reçu ce
label, car il a en fait pour but d'affranchir les bateaux de certaines
taxes. Or seuls les bateaux maritimes sont assujettis à celles-ci.
Jusqu'à tout récemment (2011) un bateau fluvial ne pouvait pas recevoir
ce label, uniquement pour cette raison. Lacune comblée puisque la
Fondation, en 2011, a étendu le label aux bateaux fluviaux. La
procédure à suivre est plutôt simple : d'abord un questionnaire en ligne (Internet)
sur le bateau, avec quelques pièces jointes (photos et documents
relatifs à l'histoire du bateau), puis un dossier papier à envoyer.
Nous ne saurions trop suggérer aux propriétaires de beaux bateaux
fluviaux de déposer une candidature, afin de faire poids et de montrer
que l'eau douce, elle aussi, porte des bateaux, et pas que des laids.
Bateau-lavoir
: grand
lavoir flottant,
conçu pour accueillir de nombreuses lavandières.
Le bateau-lavoir est un établissement privé et
payant à l'usage du public. Au contraire du moulin-bateau,
le bateau-lavoir
est généralement statique et ne se
déplace qu'exceptionnellement, son emplacement lui est
attribué par décision administrative. On
connaît néanmoins le cas de bateaux-lavoirs qui se
déplaçaient pour aller au-devant de leur
clientèle. Il en reste deux aujourd'hui en France,
conservés dans un but patrimonial. Ils sont tous deux
à Laval et classés MH.
Bateau-mouche
: bateau
de transport touristique de passagers, pour des
croisières relativement brèves, de l'ordre de une
à quatre heures. Les premiers de ces bateaux ont
été construits dans le quartier de la Mouche,
à Lyon, d'où leur nom.
Bateau
nantais
: évolution
ultime du chaland
de Loire, localisée à la basse-Loire.
Cette évolution, qui se passe au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle, fait abandonner
progressivement par le chaland, d'une part sa piautre
au
profit d'un gouvernail axial à ferrures, d'autre part sa levée
au profit d'une étrave.
Et
enfin le
sens d'abaissement du mât change avec l'adoption de treuils
métalliques plus petits et plus commodes que le gros guinda :
désormais, le mât s'abaisse non plus vers
l'avant mais vers l'arrière. En revanche, le bateau nantais
conserve de ses origines l'assemblage des bordés à clins,
qui ne sera
abandonné à son tour qu'avec la construction
métallique qui apparaît dans les années
1920.
Bateau-porte
:
bâtardeau se présentant comme une sorte de
grande coque métallique bombée, et qui vient se
placer comme un bâtardeau
classique
pour
le même usage. Cette coque peut se remplir ou se vider d'eau
selon qu'on veut la placer ou l'enlever.
Batelet :
terme administratif, synonyme de "bachot".
Batelier :
personne dont la profession consiste à transporter de la
marchandise ou des personnes par la voie fluviale, avec un bateau dont
il a la propriété ou simplement la
responsabilité. Synonyme : marinier. Batelier est
plutôt employé dans le sud. Voir le site du Musée
de la Batellerie.
Batellerie :
le mot a plusieurs sens, tous dérivés les uns des autres. Il désigne
l'activité
qui consiste à transporter des marchandises par voie d'eau. Il désigne
aussi
la corporation qui effectue ce travail. De même l'emploie-t-on pour
désigner
l'ensemble des gens et bateaux particuliers d'une région ; on parle
ainsi de
la batellerie bretonne, de la batellerie d'Alsace, etc...
Liens
: Navigation,
Ports et Industries, société
de transport fluvial Mindoro
Batillage : vagues plus ou moins hautes formées
par les mouvements des bateaux. En canal, la vitesse est limitée à 6 ou
8 km/h pour éviter que le batillage ne soit trop agressif pour les
berges, et les érode prématurément. On dit aussi parfois "babillage".
Bâtiment : bateau de plus de 20 tonnes. Il est
prioritaire sur les bateaux plus petits.
Battre en arrière : inverser le sens de rotation
de l'hélice, généralement pour s'arrêter (il n'y a pas de frein sur un
bateau !).
Bau : sur un bateau, pièce de charpente
transversale placée à une certaine hauteur par rapport à la sole, et
destinée à maintenir l'écartement des bords. Ce terme est plutôt
maritime et en batellerie, on lui substitue ceux de "overgands" ou
"matières".
Par extension, ce terme désigne aussi la largeur du bateau.
Bauquière : sur un bateau, pièce de renfort
longitudinale fixée à la paroi interne du bordé, et destinée à recevoir
l'extrémité du bau.
Bé de cane
: forme
primitive du bateau berrichon,
directement adaptée
du chaland
de Loire, dans les années 1830. Ce terme vient de la forme de
la levée avant de ce bateau, qui
évoquait (avec un peu d'imagination) un bec de canard. C'est la même
étymologie que l'outil du menuisier, le bédane.
Pour
en savoir plus sur le canal de Berry et ses bateaux, voir l'ouvrage "Un canal pas
comme les autres, le canal de Berry ". (cliquer
sur le titre)
Bêche : ancien bateau de la Saône, synonyme de "bâche".
Becquey (Louis) (1760-1849) : Directeur Général
des Ponts et Chaussées, ce qui équivalait à une charge de Ministre des
Travaux Publics sous la Restauration, de 1817 à 1830, à qui la France
doit la majeure partie de son réseau fluvial. Devant la montée en
puissance de l'industrie et sa demande croissante en moyens rapides et
fiables d'approvisionnement et de débouchés des centres industriels,
Louis Becquey promulgua les 5 août 1821 et 14 août 1822, une série de
lois connue sous le nom de "Plan Becquey", destinées à permettre la
création d'un grand réseau fluvial moderne. Physiquement, le Plan
Becquey est basé sur deux points. Le premier est l'ouverture de nouvelles
voies d'eau, canaux et rivières canalisées, par des mesures
financières incitatives, et la modernisation des voies déjà existantes
(les grands canaux de jonction de l'Ancien régime, notamment, comme
ceux de Briare,
du Midi,
d'Orléans,
de Picardie, du Centre...).
Le deuxième point est la première vraie normalisation
des ouvrages de tout ce réseau sur un gabarit minimum unique :
30,40 m sur 5,20 m, avec une hauteur libre de 3 m, et
un mouillage
de 1,60 m (pour un tirant d'eau de 1,20 m). Freycinet ne fera que
reprendre l'idée 58 ans plus tard. Cette normalisation a connu quelques
exceptions, comme en Bretagne, en Cotentin et en Berry. Elle a
néanmoins été très largement appliquée ailleurs, et un tel gabarit a
permis une navigation sûre, sur de très grandes distances, à des
bateaux portant jusqu'à 150 tonnes. Quant au volet financier du plan,
il consistait en un mélange original de concession et
d'emprunt dans lequel l'Etat assumait la plus grande part des
risques, en plus des travaux, et dont les mesures avantageuses ne
pouvait qu'inciter les compagnies concessionnaires à se lancer dans la
construction de nombreux canaux. À Louis Becquey et à son plan, nous
devons la plupart des canaux latéraux, plusieurs canaux
de jonction supplémentaires (ou leur achèvement), le tout
totalisant plus de 3000 km, et de nombreuses rivières
canalisées. Le gabarit Becquey a été presque totalement
éclipsé par celui de Freycinet à la fin du
XIXe siècle, mais on peut néanmoins retrouver ce gabarit des années
1820-1830 sur une partie du canal du Nivernais
(entre Cercy-la-Tour et Sardy-lès-Epiry), le Cher,
la quasi-totalité des rivières angevines et occitanes, le versant Seine
du canal
d'Orléans (cette
liste n'est pas exhaustive).

Louis Becquey (1760-1849), lithographie
de Engelmann
(Portrait aimablement transmis par Solange Becquey,
arrière-arrière-petite-nièce de Louis Becquey, que nous remercions)
Pour
en savoir plus sur Becquey et son plan, suivre ce
lien
Bélandre : ancien bateau
de canal originaire des
Flandres, et apparenté à la péniche
flamande. La bélandre a
des formes encore plus pleines que cette dernière, presque
caricaturales.
Béquille
: voir "brimballe".
Bergade : Sur
la Dordogne
et l'Isle,
perche ou bourde employée pour diriger le bateau en l'éloignant des
rochers et hauts fonds.
Berge : limite physique entre la surface liquide
et la terre ferme.
Berrichon : ancien bateau
de transport, devenu très
rare, aux dimensions adaptées à la navigation sur le canal
de Berry, au gabarit réduit. Un berrichon a
à peu près les dimensions d'une voiture de train Corail, soit 27,50 m
sur 2,60 m.
Naviguer avec un tel bateau garantit un succès certain, notamment
auprès des mariniers pour qui il est emblématique de la grande époque
de la batellerie, où on les comptait par centaines. Il en reste
aujourd'hui moins d'une dizaine.
Pour
en savoir plus sur le canal de Berry et ses bateaux, voir l'ouvrage "Un canal pas
comme les autres, le canal de Berry ". (cliquer
sur le titre)
Bertingue :
Sur les bateaux du centre de la France, synonyme d'hiloire. Sur le bateau berrichon : bortingle.
Besace
: Sur
la Loire, bateau de queue d'un couplage, décalé de quelques
mètres vers l'arrière par rapport au "boutavant" ou bateau de tête.
Synonyme : coue ou bateau de coue.
Besogne
: ancien bateau
de charge de la basse-Seine, qui a succédé au foncet aux
XVIIIe et XIXe siècles.
Betchète
:
bateau de petite taille (19 m sur 2) d'origine wallonne. Sa forme
l'apparente à la mignole
ardennaise. (Lien Wikipédia)
Béton
: la
guerre de 14-18 a consommé beaucoup d'acier. Pour pallier ce manque,
l'on expérimenta, avec succès, la construction de bateaux en béton
armé. Etonnemment, ce matériau vieillit bien et certains bateaux de
ciment naviguent ou flottent encore. On peut voir de nombreuses batais en
béton dans le Marais Poitevin. Des voiliers aussi ont bénéficié de
cette expérimentation. Lien : Jules,
voilier en béton armé.
B.I.P. : Voir "bateau
d'intérêt patrimonial"
Bief : à l'origine, canal artificiel d'amenée
des eaux vers un moulin. Par la suite, le terme s'est étendu à la
portion de rivière comprise entre deux moulins, puis enfin à la partie
de canal comprise entre deux écluses. Le F, qui est d'introduction
récente (on écrivait "biez", ou même "bié" jusqu'au XIXe siècle), se
prononce ou non selon les régions. Un bief porte toujours le nom de
l’écluse qui le soutient, sauf dans le cas d’un bief de partage, qui ne
porte pas d'autre nom que celui-ci même de "bief de partage" (voir
ci-dessous)*, car soutenu par les deux écluses situées à chacune de ses
extrémités. Etymologie : celte "bedo" ou "bed-alo" : lit (cf. l'anglais
"bed" et l'allemand "Bett").
*Il peut cependant porter un nom non officiel inspiré par un
lieu qu'il arrose. Par exemple on peut parler du "bief de Montchanin,
ou de Longpendu" pour le bief de partage du canal du Centre.
Bief de partage : sur un canal joignant deux
vallées en franchissant une ligne de collines, bief le plus élevé du
canal, où arrive, par des rigoles,
la majeure partie de
son eau d'alimentation stockée dans des étangs-réservoirs. Un tel
canal, dit "de jonction à bief de partage", est comparable à une route
reliant deux vallées en passant par un col, le bief de partage étant ce
col. L'invention en est attribuée à Adam de Craponne au XVIe siècle, et
la concrétisation à Hugues
Cosnier au siècle
suivant (canal de Briare).
Le
difficile choix d'un bief de partage : le cas du canal de Bourgogne (Cliquer
ici)
Bigue
: grue montée sur un ponton
flottant, pour effectuer des travaux sur le canal ou la
rivière, ou sur des bateaux. Le mot viendrait, selon le
Larousse, du provençal "biga" qui signifie "poutre". Nous y
voyons aussi, et ce n'est pas contradictoire, une
déformation de "bique" qui, dans le langage populaire,
désigne une chèvre, cette dernière
étant tout aussi bien le sympathique caprin que nous
connaissons, qu'un engin de levage assez rustique, mais très
semblable dans son principe, à la bigue des travaux
hydrauliques.
Bilge
: dans le fond du bateau, mélange pas très ragoûtant d'huile et d'eau.
Bille, billard, billette
: mèche
de la piautre du
chaland
ou du fûtreau
de
Loire. La "bille" (ou "billard" ou "billette"), qui repose sur les ménicles
et le tableau
arrière est
très oblique.
Biller : sur
la Loire, faire pivoter le bateau le nez vers l'amont pour freiner sa
descente et franchir un pont en toute sécurité. C'est le travail du
billeur. Plus généralement en marine de canal, accrocher l'attelage ou le moyen de traction depuis la terre à la fintrelle ou corde de traction du bateau
Billot :
sur un chantier de construction navale, ce terme désigne un
fort plot posé sur le sol et qui supporte une
cöette, fort madrier transversal sur lequel on construira le
bateau.
Birran : sur le lac Léman,
brise thermique nocturne qui souffle depuis la terre dans la région de
Thonon-les-Bains.
Bisoton :
sur le lac Léman, brise thermique nocturne qui soufle du nord, comme la
bise.
Bitte :
organe d'amarrage en forme de champignon plus ou moins gros et fixé à
terre sur
un quai ou un couronnement d'écluse. Etymologie, le norrois biti.
Bitton : pièce en fonte fixée sur les fargues et servant à guider un câble. On dit aussi chaumard.
Bizet
(vent):
terme ligérien pour désigner le vent du nord, la bise.
Blanc : remorqueur qui voyage sans convoi, à vide.
Bleus : ancienne société de remorquage basée à Conflans-Sainte-Honorine
Blin : barque de la
Brière, plus grande que
le chaland.
Blina : pièce d'étrave spécifique au blin de
la Brière. Cette pièce rappelle, par sa forme en escaliers symétriques,
les pignons des maisons flamandes,
à l'envers et plus étroit.
Bloc
: poulie
(dans le Nord).
Boête
: prélèvement en nature sur la cargaison, dans des limites fixées
contractuellement, qui était autorisé aux mariniers de Loire quand ils
transportaient du vin ou du sel, ce qui était assez fréquent. Ce droit
a été institué pour
éviter les mises en perce abusives et clandestines qu'effectuaient
auparavant les mariniers qui dénaturaient le vin en remplaçant celui
qu'ils avaient bu par de l'eau. Ne pas confondre avec le "droit de
boête" (voir ci-après).
Boête
(droit de)
: taxe prélevée par la "Communauté des Marchands Fréquentant la Rivière
de Loyre et autres Fleuves Descendant en Ycelle" sur les marchandises
transportées. Le produit de cette taxe était affecté aux travaux
d'entretien de la navigabilité de la Loire et de ses affluents. On a
ainsi une sorte de paradoxe, nous dit Françoise de Person, historienne
de la Marine de Loire : la Communauté luttait contre les péages féodaux
abusifs, institués souvent depuis fort longtemps, et qui devaient
servir au même usage (mais souvent les seigneurs n'honoraient pas leurs
engagements). Mais elle s'est vue contrainte d'en instituer un
elle-même pour remplir sa mission !
Boieraak : bateau
de charge hollandais, de
forme intermédiaire entre l'aak
et le tjalk.
Couramment aménagé pour la plaisance.
Boille :
sur le lac Léman, bouée ou gros flotteur en fer-blanc, aujourd'hui en
plastique.
Boire : bras mort sur la Loire moyenne et basse ainsi que l'Allier.
Sur la haute Loire, le terme rhodanien de "losne" (ou "lône") a
tendance à
supplanter "boire".
Boitas
: sur les bateaux de Loire, long espar horizontal, placé au pied du
mât, et destiné à écarter le point d'écoute de la voile afin d'offrir
au vent la plus grande surface de toile possible. Etymologie :
scandinave "beitas".
Boite à pompe : sur les bateaux en bois, long
tube cylindrique vertical, fixé le long d'une membrure
au niveau du sentineau
et
descendant le plus bas possible, et destiné à recevoir le corps de
pompe (la "célestine").
Bollard, boulard, bitte : organes d'amarrage
cylindriques ou en forme de champignon, sur le quai ou le bateau. Pour
désigner l'organe à quai, le marinier emploie volontiers le terme
"pieu".

Bollard
d'écluse.

Bollards de bateau.
Bollard
ou boulard
flottant : bollard qui accompagne la descente ou
la montée du bateau dans l'écluse, ce qui est
très pratique. Monté sur un gros flotteur, il
coulisse entre deux rails verticaux qui lui servent de guides,
à l'intérieur d'une grosse rainure
ménagée dans le bajoyer. Des bollards flottants
équipent généralement de hautes
écluses comme sur le canal
du Centre ou
le Rhône,
mais on en trouve aussi sur le canal
de l'Ourcq,
dont les
écluses ont une chute moyenne de... 50 cm ! (Il y avait sûrement une
enveloppe
budgétaire trop lourde...). On aimerait en voir plutôt sur certains
canaux comportant
des écluses de haute chute, comme Roanne-Digoin.

Bollard flottant de l'écluse de St-Pierre-Bollène, sur le Rhône
Bonde
: vanne placée au fond de la cuvette d'un canal ou d'un
étang-réservoir, et dont la fonction est de permettre, si besoin est,
la vidange la plus complète possible de l'ouvrage. Synonyme : vanne de fond.
Bonget :
Grosse défense ronde en chanvre tressé, remplie de liège, pour protéger
la péniche
en cas de choc.
Bord,
bordé : planche constitutive de la bordaille.
Etymologie, le norrois bord, planche. Le mot est
passé, comme beaucoup d'autres d'origine fliuviale, dans le langage
courant. L'ensemble des bords d'un côté constitue le bordé
ou la bordaille.
Bord à
bord
: Se dit lorsque deux bateaux sont à couple.
Bordaille
: flanc du bateau.
Bord d'hors
:
sur une rivière canalisée,
côté
opposé à la rive aménagée
pour le halage.
Voir "avaterre".
Bord du dessous : partie de la bordaille immergée à vide, ou "oeuvres vives".
Bordé
(être) : en
canoë, on est
"bordé gauche" quand on pagaie
à
gauche, et "bordé droit" quand on pagaie à
droite, bien
sûr. On peut se "déborder" ponctuellement pour des
manoeuvres spécifiques.
Bornan: sur le lac Léman, vent
du sud dominant et traitre, brusque et fort, qui affecte
particulièrement la région d'Evian, Thonon et Meillerie. Il peut
atteindre 7-8 beaufort.
Borne fluviale : borne,
généralement en pierre, sur laquelle sont
portées diverses indications, et notamment la distance du
lieu par rapport au point d'origine de la navigation.

Borne de
Loire au port d'Artaix (Saône-et-Loire).

Une
borne semblable à Châteauneuf-sur-Loire
(Loiret)
Bortingle :
hiloire
ou denbords
(se dit dans le Centre et plus spécifiquement en Berry).
Bosse : rive
intérieure d'un méandre,
convexe. Il s'y forme généralement de l'aï.
Contraire : "creux"
ou "ganche".
Autre sens : en canoë-kayak, la bosse
désigne une corde de sécurité.
Bossoir : sorte de petite grue ou potence permettant la mise à l'eau et la remontée d'un bachot.
Bot
: digue dans le Marais
Poitevin. On écrit parfois "booth" sous l'influence du hollandais (les
Hollandais ont contribué à
l'aménagement de cette région). Le "contre-bot",
ou "contrbot" (non, il n'y a pas de coquille) est un fossé
de drainage établi à la base du bot.
Bouchain
: sur un bateau de type automoteur
métallique,
partie arrondie qui réunit la bordaille
verticale et le fond du bateau (la sole),
horizontal. Quand cette partie forme un angle droit, on parle de
"cornière" ou
d'"enchème".


Deux
vues d'une coque hollandaise à bouchains
Ce terme peut se restreindre à
désigner la partie arrondie de la coque qui relie l'étrave
à la
sole. Dans ce cas, on parle de "genouillère"
pour désigner la partie arrondie entre la bordaille et la
sole.
Sur un kayak ou un canoë, le bouchain
désigne plus globalement le flanc arrondi du bateau.
Bouchure : élément amovible de certains systèmes
de pertuis
se présentant
comme une planchette rectangulaire d'environ 40 cm sur 30, et muni d'un
manche plus ou moins long selon son rang en hauteur dans le pertuis
fermé. Synonyme dans ce sens : apparêt.
Dans les barrages modernes, ce mot désigne, par extension,
toute une partie mobile de l'ouvrage,
généralement un clapet hydraulique ou
mécanique.
Pour
en savoir plus sur les pertuis et portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse".
(cliquer sur le titre)
Boucle : Extrémité d'un cordage formant une
boucle au moyen d'une épissure
et servant à l'amarrage. Synonyme : gonette.
Bouffer de la lune
: naviguer en dehors des heures légales d'ouverture des écluses, en
demandant à passer en régulation.
On dit
aussi "brûler son matelat".
Bouge : sur un bateau, convexité du pont,
transversale et vers le haut. Elle a pour but d'éviter que l'eau stagne
sur celui-ci et de faciliter son écoulement vers l'extérieur, où elle
sort par les dalots.
Boulée (vannettes) : planchettes en
bois et métal, héritères des apparêts
des anciens pertuis,
destinées
à assurer la bouchure
de barrages
mobiles.
Leur nom vient
de leur inventeur, l'ingénieur Boulée, au XIXe
siècle.
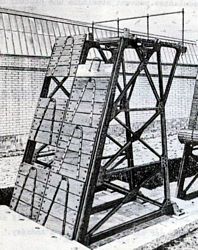
Vannettes
Boulée du barrage de Suresnes (Seine)

Vannettes
Boulée en place sur un barrage de la haute Seine. (photo
E.Berthault)
Bouline : sur la Loire :
cordage qui maintient la voile en avant pour l'aider à "faire les
fesses" et lui faire prendre le vent dans la meilleure direction. Elles
sont au nombre de deux et fixées, une extrémité à mi-hauteur du bord de
la voile, et l'autre extrémité à l'avant du bateau. On dit aussi
"boute-vent", à ne pas confondre avec "boutavant".
Boulon plongeur : boulon à tête plate et percé à l'autre extrémité de façon à y passer un petit cordage, et servant à boucher en urgence une voie d'eau.
Bourde :
sur la Loire : perche ferrée
servant à manoeuvrer en prenant appui sur le fond.
Bourdonnière
:
grosse pierre taillée du radier
de
l'écluse, qui porte le pivot
de la crapaudine.
Bournayage ou
bournoyage
: sur les anciens
bateaux de rivière, en particulier sur la Loire, technique
particulièrement violente et dangereuse
d'évitement des obstacles par usage du bâton de
marine et des arronçoirs.
Bourrer
: remplir manuellement, à la pelle, les endroits inaccessible de l'houle (la cale).
Bourse
d'affrêtement :
bâtiment public appartenant à VNF, où
sont attribués les frets, selon des règles bien
précises.
Bout à
quai :
position du bateau
garé le nez contre la berge, dans les gares d'eau, ce
qui permet de
gagner de la place.
Dans le large du Bassin-Rond, sur l'Escaut, il y avait
jusqu'à
80 péniches garées ainsi bout à quai,
en attente
de passer l'écluse d'Iwuy.

Bateaux
amarrés bout à quai dans la gare d'eau de
Dorignies,
près de Douais, sur la Scarpe. (photo J-Claude Verrier)
Boutavant
: dans un couplage
d'anciens bateaux
de
Loire, ce mot désigne le bateau placé en avant de
l'autre, de quelques mètres. L'autre bateau est le "bateau
de coue" (bateau de queue) ou "besace".
Boute-vent :
voir bouline.
Bouter : action qui permet de repousser, depuis
son bord, un bateau tractionné
et
de le maintenir loin de la rive, en poussant sur une longue et forte
perche ou
bâton de marine.
Bouteur
: sur les bateaux de commerce, gouvernail avant,
escamotable, et
bien pratique en cas de grand vent latéral quand le bateau
est vide, donc haut sur l'eau.

Bouteur
escamoté dans la coque à l'avant d'un freycinet
Bracon : sur les portes d'écluse en bois, le
bracon est un fort madrier oblique qui renforce le vantail
et maintient sa quadrature. Il va du coin formé par l'entretoise
haute et le poteau
busqué, au
coin opposé formé par l'entretoise basse et le poteau
tourillon. C'est exactement la même disposition que sur des
volets ou des portes de grange en bois, et l'ensemble, pour un vantail
droit vu d'aval (donc à gauche), dessine un Z. Si la porte est très
haute, une porte
aval par exemple, il peut y avoir deux bracons de part et d'autre de
l'entretoise médiane, l'ensemble dessinant, pour un vantail droit vu
d'aval, deux Z l'un sur l'autre. On parle aussi d'"écharpe".
Autre sens : sur les bateaux de Loire, autre nom donné aux épontilles.
Brai : sur les bateaux de Loire, cordage qui
lève la partie inférieure de la voile de manière à ménager une
"fenêtre" par laquelle peut voir l'homme qui gouverne à la piautre.

Action du brai
(bateau "Montjeannaise")
Braies
: sur les bateaux
de Loire, haubans qui
maintiennent le mât.
Braye
: sur la Loire, filet de pêche
en forme d'entonnoir (cf Saint Jean de Braye).
Brêlage,
brêler un convoi : solidariser,
arrimer entre eux les éléments d'un convoi
poussé : pousseur
et barges.
Pour
l'opération inverse, on dit "débrêler",
mais aussi "casser un convoi".
Brick
ou bricq : sur le
Rhône,
ancrage de
sécurité constitué d'un long espar de
bois muni à son extrémité
d'un pic à trois dents. Cet espar coulisse dans un logement
vertical ad hoc ménagé dans le bateau et on
l'enfonce au fond pour s'amarrer. Ce système a
été repris sur les grands remorqueurs
à roues
à aube du Rhône au XIXe siècle. On trouve ce système actuellement sur
des bateaux de commerce et ailleurs que sur le Rhône. Il est très
pratique car il permet d'éviter de chercher un amarrage à terre.
Bricker
ou bricquer : sur le
Rhône,
s'ancrer au brick (voir ci-dessus).
Autre sens : pour un jouteur,
tomber à l'eau.
Bricole
: large harnais
que se passe le haleur
en bandoulière pour tirer le bateau sans être
blessé. "Halage à la bricole" est synonyme de
"halage humain". Synonyme : las.

Halage à la bricole sur le canal de
Berry au début du XXe siècle.
Autre sens : type de
bateau de la vallée de la Sarre, apparenté à la mignole
et au scute. On précise
même "la bricole sarroise".
Brigade Fluviale : Voir cet
article
(en chantier)
Brimballe ou brimbelle
: système rudimentaire de manoeuvre des vantaux
d'une écluse, en l'absence de tout cric, cabestan ou vérin. La
brimballe est une longue tige métallique articulée par une rotule à la
passerelle du vantail, et munie d'une poignée
à son autre extrémité. Il suffit de tirer ou pousser sur cette dernière
pour ouvrir ou fermer le vantail. Rudimentaire, certes, mais d'une
fiabilité sans faille. Synonyme : béquille.

Brimballe de l'écluse de
Maillé, sur le canal de
Bourneau
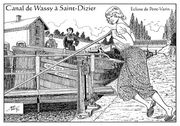
Manoeuvre d'écluse à la brimballe.
Brise-lame
: cornière placée
sur le denbord
(ou hiloire), de
façon à empêcher les
vagues d'entrer dans la cale, surtout lorsque le bateau est bien
chargé en rivière.
Brize
: dans la terminologie des anciens pertuis,
synonyme de "volée".
Bronquer
: sur le
Rhône, heurter une
pile de pont.
Brotteau :
sur le Rhône, broussailles
près d'un cours d'eau, îles et bancs de graviers où
peut paître le bétail. Ce mot a donné son nom
à un quartier et une gare ferroviaire de Lyon, aujourd'hui désaffectée.
Brûler
son
matelas : synonyme de "bouffer
de la lune" .
Busc : marche
en maçonnerie, formant un angle pointé vers l'amont,
contre laquelle s'appuie la base de la porte d'écluse
fermée qui est dite alors "porte busquée".
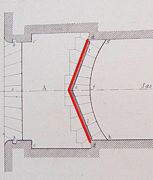
Plan d'écluse : le busc (manuel de
l'ingénieur De Bauve 1878)

Busc de la porte
amont de l'écluse d'Orléans, en cours de réhabilitation en 2007
Butée
(d'arrêt) : sur les anciens pertuis,
pierre ou pièce métallique en saillie sur le couronnement,
sur la rive
opposée au chandelier,
et arrêtant la course de la volée
vers l'aval.
 Butée
d'arrêt (maquette de pertuis)
Butée
d'arrêt (maquette de pertuis)
Pour en savoir plus sur les pertuis et portes
marinières, voir l'ouvrage "Du
pertuis à l'écluse". (cliquer sur
le titre)
Butte (taper dans
la butte) : se
dit lorsque l'on
remonte une rivière en crue.
Butty : narrow-boat
dépourvu de
moteur. Dans la batellerie britannique, le
marinier possède souvent deux narrow-boats qui naviguent
l'un remorquant l'autre dans les canaux étroits, ou
à couple dans les rivières et canaux larges. Dans
les deux cas, il suffit qu'un seul des bateaux soit
motorisé, c'est le "motor-boat", et l'autre est le "butty".
"Butty" est une déformation de "buddy" qui signifie
"compagnon".